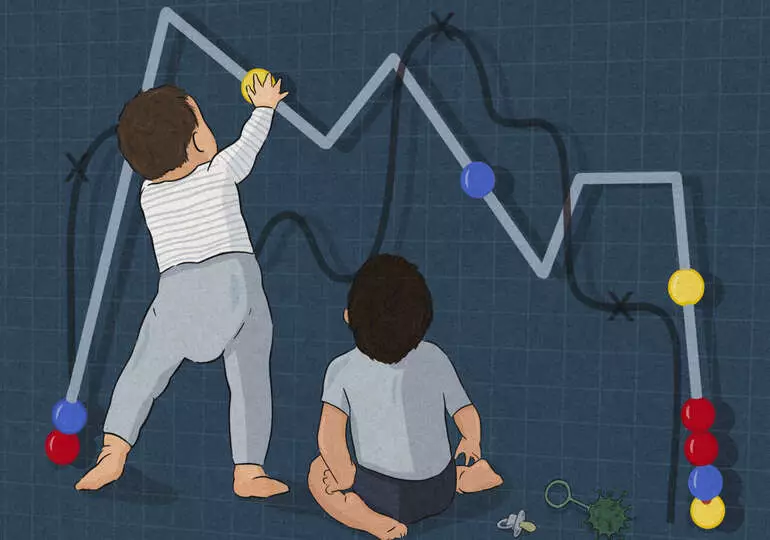En 1994, le taux de fécondité était de 1,7 enfant par femme. Les autorités escomptaient alors le maintien de ce taux de fécondité grâce au développement des grossesses tardives, au-delà de 35 ans.
En 2024, le taux de fécondité est tombé à 0,7 en Corée du Sud, un des plus faibles au monde. Depuis 2006, l’État coréen a dépensé plus de 270 milliards de dollars, soit un peu plus de 1% du PIB par an, pour encourager la procréation d’enfants. Toutes les mesures prises n’ont eu aucun effet sur le taux de natalité qui continue de baisser. La Corée du Sud est le cas extrême d’un phénomène général.
Tous les pays occidentaux, à l’exception d’Israël, connaissent un mouvement de repli de la natalité. Ce dernier est devenu un sujet politique comme en témoigne la prise de position d’Emmanuel Macron qui réclame un « réarmement démographique ». Le fondateur de Tesla, Elon Musk, souligne de son côté que la civilisation humaine est menacée d’extinction.
Presque tous les pays riches envisagent donc l’augmentation de leurs efforts en faveur de la natalité.
Le déclin démographique rime avec celui de la croissance. Il s’accompagne de la multiplication des tensions sociales et politiques. Presque tous les pays riches envisagent donc l’augmentation de leurs efforts en faveur de la natalité tout comme de nombreux pays à revenu intermédiaire.
Le candidat Donald Trump promet « des primes pour un nouveau baby-boom » s’il est réélu en novembre. La Chine, connue depuis longtemps pour sa politique de l’enfant unique, propose des aides pour la garde d’enfants et des allègements fiscaux afin d’encourager les parents à avoir trois enfants. La Norvège offre aux mères près d’un an de congé, avec des revenus avant la naissance de l’enfant fournis par l’État, ainsi que de nombreux services de garde d’enfants.
Avec la Suède et le Danemark, la France est l’un des pays de l’OCDE dont le poids des aides en faveur des familles au sein du PIB est le plus important. Il se situe depuis vingt ans entre 3,5 et 4 % du PIB par an. La palette des dispositifs est une des plus large au monde. Pourtant en 2023, jamais le pays n’avait enregistré un aussi faible nombre de naissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le lien entre dépenses en faveur des familles et naissances est ténu.
Le lien entre dépenses en faveur des familles et naissances est ténu. En Europe du Nord, les mesures de soutien, mises en œuvre dans les années 1980, ont eu un effet à court terme. Les familles s’habituent aux prestations qui au fur et à mesure perdent leur rôle d’incitation aux naissances. Elles peuvent même aboutir à la réduction de leur nombre.
Des études ont ainsi souligné que l’allongement du congé de maternité incite les femmes à retarder la naissance de leur premier enfant et à en avoir moins au cours de leur vie. Ces études soulignent que les couples hétérosexuels dans lesquels un homme prend un congé de paternité sont moins susceptibles d’avoir un autre enfant. D’autres études indiquent que les aides génèrent des effets d’aubaine. Elles profitent à des parents qui, de toute façon, avaient décidé d’avoir des enfants. Le coût public de chaque nouvel enfant s’accroît. En Israël, le coût de la politique familiale par enfant atteindrait plus d’un million. En dix ans, en France, ce coût aurait été multiplié par deux.

La baisse de la fécondité concerne essentiellement les jeunes femmes. Aux États-Unis, le nombre de naissances chez les femmes de 20 à 24 ans a été divisé par plus de deux de 1990 à 2023. Il a diminué de 33 % pour celles de 25 à 29 ans comme pour celles de 30 à 34 ans. Il a, en revanche, légèrement augmenté pour les femmes âgées de 35 à 44 ans. Par ailleurs, il y a une quasi-disparition des naissances entre 16 et 19 ans. Au Royaume-Uni les femmes nées en 2000 ont eu deux fois moins d’enfants avant l’âge de 20 ans que celles nées en 1990.
Au sein de l’OCDE, le souhait des femmes est d’avoir 2 enfants mais dans les faits, une sur deux se contente d’un enfant.
Les femmes désirent moins d’enfants qu’auparavant et l’écart entre les intentions et la réalité tend à s’accroître. Au sein de l’OCDE, le souhait des femmes est d’avoir 2 enfants mais dans les faits, une sur deux se contente d’un enfant. Les pouvoirs publics tentent d’aider les femmes les plus jeunes à avoir des enfants.
En Chine, la province du Zhejiang, située à la frontière orientale de la Chine, offre aux nouveaux mariés une somme forfaitaire, mais à condition que la mariée ait moins de 25 ans. En Russie, les femmes qui ont un enfant avant l’âge de 25 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu. La Hongrie offre un avantage similaire aux mères qui ont leur premier enfant avant 30 ans.
D’autres pays ciblent les familles à revenus modestes. La ville de Flint, dans le Michigan, accorde à chaque femme 7 500 dollars, distribués en plusieurs fois, à partir du moment où elle tombe enceinte jusqu’au premier anniversaire de son enfant. Cette aide peut représenter jusqu’à 75 % des revenus du ménage. L’objectif poursuivi par les pouvoirs publics était de réduire les avortements motivés par la faiblesse des revenus des mères. Les femmes bénéficiaires de cette aide ont souligné qu’elle était insuffisante au vu des dépenses liées à l’arrivée d’un enfant, évaluées à 20 000 dollars.
Développer les crèches ainsi que les mesures de soutien aux ménages modestes
Aux États-Unis, les politiques pro natalistes ne sont pas sans lien avec la volonté de certains élus de vouloir remettre en cause le droit à l’avortement. Des associations s’opposent aux mesures d’incitation à la procréation destinées aux jeunes femmes ou aux familles modestes en soulignant que les enfants qui en sont issues sont ceux qui ont le plus de problèmes de santé et qui rencontrent les difficultés les plus importantes au niveau scolaire.
Les études européennes comme américaines soulignent que les politiques familiales ont des effets limités sur le taux de fécondité et de natalité surtout sur le moyen et le long terme. Afin d’assurer l’égalité des revenus entre hommes et femmes, il apparaît nécessaire de développer les crèches ainsi que les mesures de soutien aux ménages modestes, mais cela n’induit pas un changement des comportements qui dépendent de facteurs autres que purement financiers.
Laisser un commentaire