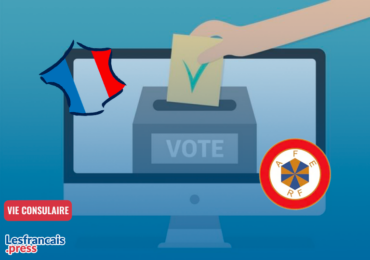Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le cours des matières premières, de l’énergie et d’un certain nombre de biens intermédiaires, notamment les engrais connaissent une augmentation brutale au point que, désormais, l’appellation de choc pétrolier est avancée pour caractériser la situation.
Fin 2021, l’économie mondiale se remettait à peine des effets de la crise sanitaire de 2020 au prix d’un endettement en forte hausse et d’une inflation résurgente. Celle-ci qui devait être temporaire ne peut que s’amplifier. Avec la crise ukrainienne, elle prend une autre tournure. Née de la désorganisation de l’offre et d’une demande portée par les plans de relance dans un contexte d’abondantes liquidités, elle est désormais le résultat d’un choc d’offre.
Les chocs d’offre sont provoqués par le rôle joué par la Russie et l’Ukraine sur les marchés des produits agricoles, des matières et de l’énergie ainsi que sur ceux de plusieurs biens intermédiaires. La Russie est, en effet, un des principaux producteurs de matières premières et d’énergie. La hausse des cours constatée depuis le début du conflit n’est pas la conséquence d’une pénurie. Jusqu’à maintenant, les quantités produites, vendues et distribuées n’ont pas diminué. L’augmentation des prix est le fruit d’anticipations et d’inquiétudes face à des menaces d’approvisionnement.
Une nouvelle vague d’inflation ?
L’inflation qui était portée depuis le milieu de l’année 2021 par les plans de relance décidés lors de la crise sanitaire est désormais alimentée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, deux pays qui sur plusieurs secteurs sont des acteurs importants du commerce international. L’énergie, les métaux, les engrais, les produits agricoles sont touchés par ce conflit et par les sanctions qu’il a provoquées.
Le choc pétrolier
Le baril se rapproche de son record absolu de l’été 2008 où il avait atteint 147 dollars. L’augmentation d’alors avait conduit les banques centrales à relever leurs taux directeurs afin de lutter contre l’inflation, hausse qui avait conduit à la crise des subprimes. Entre 2011 et 2012, le pétrole avait connu une nouvelle progression de son prix qui, en pesant sur la croissance, a rendu plus criants les déséquilibres financiers de la Grèce. À compter des années 2010, la montée en puissance du pétrole de schiste a provoqué une forte baisse des cours qui se sont même effondrés durant l’été 2016 à 27 dollars du fait du refus de l’Arabie Saoudite de jouer le rôle de régulateur en dernier ressort. Après plusieurs mois de guerre des prix, les pays membres de l’OPEP et la Russie ont conclu un accord de limitation de la production qui a été reconduit depuis. Ce dernier a même été durci au moment de la crise sanitaire qui lors des premiers confinements avait entraîné une baisse sans précédent du baril (17 dollars le baril au mois d’avril 2021). Depuis le début du conflit en Ukraine, la hausse des cours est alimentée par la crainte d’un embargo sur le gaz et le pétrole russe.
La Russie est le premier exportateur de gaz et le deuxième pour le pétrole brut. Les États d’Europe figurent parmi ses principaux clients dont certains sont en situation de dépendance élevée. En cas d’embargo, les pays importateurs devront se tourner vers d’autres fournisseurs disposant de capacités de production excédentaires. Si les pays du Moyen-Orient sont dans cette situation, ils n’entendent pas contrarier la Russie qui s’est avérée un partenaire loyal dans la cadre des accords de régulation de la production. Par ailleurs, en raison d’un sous-investissement chronique, les pays producteurs seraient peut-être dans l’incapacité de répondre immédiatement à une demande plus forte qui leur serait adressée. Plusieurs problèmes logistiques devront être résolus. Pour le gaz, le nombre de méthaniers serait insuffisant pour acheminer du gaz en provenance des États-Unis ou du Canada. De même, le nombre de terminaux pouvant recevoir du gaz liquéfie est limité. Pour développer les capacités d’importation, la réalisation d’infrastructures serait nécessaire.
Les pays les plus dépendants du gaz russe sont l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie pour lesquels il joue un rôle important dans le mix énergétique. La République tchèque, la Suède ou la Finlande important 100 % ou presque de leur gaz de Russie sont peu dépendantes car la proportion du gaz dans la consommation est relativement faible. En Italie, en revanche, le gaz représente plus de 40 % du mix énergétique, soit presque deux fois plus que la moyenne européenne. Le poids du gaz dans le mix français est inférieur à 17 %.
Pour le pétrole, la dépendance des pays européens est moindre à l’exception de quelques pays d’Europe de l’Est. Les possibilités de substitution sont un peu plus nombreuses et faciles techniquement.

Le choc agricole ?
Comme pour le pétrole, avant même le conflit, les prix étaient orientés à la hausse en raison d’un rebond de la demande et de problèmes d’acheminement. L’Ukraine et la Russie sont des puissances exportatrices de premier rang pour de nombreux produits agricoles. L’Ukraine est le cinquième exportateur de blé au niveau mondial quand la Russie se place première. Ces deux pays représentent environ un tiers des exportations de blé. L’Ukraine est, par ailleurs, le quatrième exportateur mondial de maïs avec 33,8 Mt prévu à l’export en 2021-2022 (soit 19 % des échanges mondiaux). L’Ukraine assure 50 % des exportations mondiales d’huile de tournesol. Ce taux est de 79 % avec la Russie (29 %). Sur les mois d’hiver, l’Ukraine est à l’origine de près de la moitié des exportations mondiales.
Les plaines de l’Est de l’Ukraine qui ont donné lieu aux premiers combats sont à l’origine de 30 % de la production d’orge du pays, de plus de 40 % de celle de tournesol, de blé et du maïs. Dans les prochaines semaines, les acheminements pourraient être compliqués en raison des opérations militaires en cours et de la prise de contrôle par les Russes des ports ukrainiens. L’augmentation du cours des céréales a des incidences sur la filière animale qui utilise notamment le soja, le maïs ou le tournesol.
La dépendance aux engrais
La Russie, la Biélorussie et l’Ukraine sont des exportateurs importants d’engrais, notamment les engrais azotés fabriqués à partir du gaz naturel via l’hydrogène et l’ammoniac. La Russie assure 13 % du commerce de produits intermédiaires d’engrais. Ce pays représente 24 % des exportations mondiales d’ammoniac, 40 % de celles de nitrate d’ammonium, 17 % des engrais phosphatés et 20 % de la potasse. Il est à l’origine de 16 % des échanges d’engrais finis.
Plusieurs pays sont dépendants des engrais russes. Le Brésil achète près de 60 % des volumes d’engrais azotés de Russie. L’Europe est dépendante à près de 25 % de la Russie. Une diminution de la consommation d’engrais au Brésil qui est le troisième producteur mondial de maïs aurait des conséquences sur les marchés de céréales et sur les filières animales. La Russie est également un important producteur d’engrais azotés indispensables aux céréales, à la canne à sucre et à la betterave. Ce pays fournit 17 % du marché des engrais phosphatés.
Pour la potasse, Russie et Biélorussie assurent 42 % des exportations mondiales. Ils ont comme principal client le Brésil. Le Canada, l’Allemagne, Israël et la Jordanie ne pourraient pas compenser en totalité l’absence d’exportations russes pour ces produits. En cas de carences en potasse, la production de betteraves ou de pommes de terre pourrait connaître une forte baisse de ses rendements. La France subira les hausses de prix pour les engrais sachant que le pays importe la moitié de sa consommation d’engrais. Parmi les engrais minéraux, seul l’ammonitrate est fabriqué en France et en Europe en ayant recours au gaz…
Pour réduire sa dépendance à cette matière première, l’industriel Yara, leader mondial des engrais minéraux azotés, vient d’annoncer que 30 % de ses ammonitrates seront issus de l’hydrolyse de l’eau – et non de gaz – à compter de 2023. Cette technologie nécessite des investissements massifs, l’engrais ainsi produit coûtant 4 à 5 fois plus cher que les carbonés.
Matières premières, des conséquences pour les énergies renouvelables
La Russie est le deuxième producteur de terres rares derrière la Chine. Ces terres rares sont incontournables pour les productions des microprocesseurs et pour celles de batteries. La Russie est en position de force pour l’aluminium, le nickel ou le palladium. Le groupe russe Rusal est le deuxième producteur industriel d’aluminium du monde. Il exportait auprès de nombreuses entreprises européennes que ce soit dans le secteur de l’automobile ou de l’aéronautique. Le cours de l’aluminium a dépassé 3800 dollars la tonne, à la Bourse des métaux de Londres (LME), début mars.
Le nickel qui est utilisé notamment dans les batteries électriques est sujet également à une forte hausse. Les cours en un an ont progressé de plus de 67 %. La Russie est un des acteurs majeurs du marché. En 2019, ce pays était le troisième producteur de minerai de nickel derrière l’Indonésie et les Philippines. Il occupe la deuxième place pour le nickel raffiné, derrière la Chine. De 7 à 10 % des exportations pourraient être remises en cause pour le nickel raffiné. La France avec la Nouvelle-Calédonie arrive en quatrième position juste devant le Canada et l’Australie.
La Russie contrôle 50 % du marché du palladium. Cette matière première est utilisée notamment par l’industrie de l’automobile en intervenant dans la fabrication des pots catalytiques. Le titane, métal dont la légèreté et la très haute résistance, sont exploitées par l’industrie aéronautique est également un enjeu indirect du conflit. La société russe VSMPO-Avisma, est le premier fournisseur de l’aéronautique mondiale. Le groupe français Safran ne dispose que de quelques mois de stocks.
Le retour de la stagflation
La crise ukrainienne peut provoquer un choc de nature stagflationniste, l’inflation continuant à progresser accompagnée d’un recul des salaires réels. L’inflation se rapproche de 8 % aux États-Unis et de 6 % en Europe. Les salaires nominaux connaissent des hausses plus modérées, autour de 4 % en rythme annuel que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. L’inflation est un phénomène monétaire qui prend forme sur fond de déséquilibre entre l’offre et la demande. En 2021, l’excès de la demande et la désorganisation de l’offre du fait de la crise sanitaire ont attisé les prix sur fond de liquidités abondantes. En 2022, le conflit ukrainien crée un choc d’offre avec la progression des prix de l’énergie et des matières premières ainsi que ceux de certains biens intermédiaires.
Envisagé il y a quelques semaines, le durcissement de la politique monétaire visait à contenir une inflation alimentée par la demande. Ce durcissement devant prendre la forme d’un arrêt des rachats d’obligation et d’un relèvement des taux directeurs est possiblement inadapté à la nouvelle donne économique.
Une hausse des taux d’intérêt pourrait accroître le ralentissement de la croissance qui est provoqué par l’augmentation des prix des matières et de l’énergie. Celle-ci réduit le pouvoir d’achat des ménages ce qui devrait se traduire par une diminution de la consommation globale.
Le dilemme des banques centrales
Dans un tel contexte, les banques centrales pourraient décider un report dans le temps de la normalisation des politiques monétaires. Les investisseurs anticipent un tel report et par ailleurs privilégient les actifs jugés sûrs en période de crise, les obligations d’État. Cette anticipation et cette préférence font baisser les taux.
Dans un contexte économique moins porteur, une normalisation trop rapide de la politique monétaire de la BCE conduirait à une crise de la dette publique dans certains pays périphériques où les taux d’endettement public sont élevés. En 2011/2012, la crise grecque est justement survenue dans un contexte de hausse du cours du pétrole. Ce pays dont la dette publique dépasse désormais 200 % du PIB est exposé à un risque financier en cas de hausse des taux intervenant en même temps qu’une baisse de la croissance. Il en est de même pour l’Italie, l’Espagne et le Portugal dont les dettes publiques s’élèvent à plus de 120 % du PIB. La France est juste derrière avec un taux d’endettement de 113 % du PIB. Avant la survenue de la crise ukrainienne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal à la différence de la France n’avaient pas encore effacé la perte de richesse provoquée par l’épidémie.
Le changement de pied des banques centrales est ressenti plus durement par les pays périphériques que par ceux du cœur de l’Europe. Depuis le début de l’année, les écarts de taux ont commencé à augmenter en lien avec les anticipations de hausses des taux directeurs. Une hausse des taux d’intérêt est estimée comme inefficace pour lutter contre la hausse du prix du pétrole, du gaz ou des matières premières. La hausse des taux freinera l’investissement au moment où justement il faut les augmenter pour décarboner les sources d’énergie et pour digitaliser.
L’inflation est actuellement liée aux chocs d’offre, et plus particulièrement aux anticipations de pénuries ou d’embargos. L’indice des prix de l’énergie est en augmentation de près de 30 % depuis le début de l’année. En revanche, l’inflation sous-jacente (hors prix des produits volatils et prix réglementés) est plus sage. Elle est de 3 % en zone euro quand l’inflation avoisine 6 %.
Les banques centrales et la BCE en tête sont condamnées à une grande prudence pour éviter la survenue d’une crise de la dette dans certains États et une récession. Logiquement, en ce mois de mars, la BCE devait mettre un terme à son programme de rachats d’actifs d’urgence mis en place au début de la pandémie (PEPP). Cette fin devrait traduire en acte la fin de crise sanitaire. La BCE a injecté plus de 2000 milliards d’euros pour soutenir l’économie de la zone euro en deux ans. La guerre en Ukraine l’oblige à revoir ses plans.
Laisser un commentaire