Le réchauffement climatique s’accélère et pourtant, durant tout le premier semestre, nous avons vécu au rythme des annonces de Donald Trump, de sa journée d’investiture jusqu’au cessez-le-feu irano-israélien, en passant par le « Liberation Day » du 2 avril dernier. Le monde semble gagné par un emballement économique, diplomatique, démographique et climatique. Les événements s’enchaînent rapidement les uns aux autres, avec une montée aux extrêmes médiatique, les fausses informations et les vraies se mélangeant en permanence. Si certains emballements confinent parfois à l’immobilisme — la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, ou encore la guerre commerciale — d’autres apparaissent plus tangibles. Le réchauffement climatique, au-delà de la canicule qui a frappé l’Europe à la fin du mois de juin, s’accélère, avec notamment une élévation rapide de la température de l’eau des mers et des océans.
Les prévisions les plus sombres du GIEC semblent se concrétiser avec, à la clé, des conséquences multiples sur le plan économique et social. Face à cette situation, les gouvernements paraissent de plus en plus paralysés, pris en étau entre les différents groupes de pression et une opinion traversée par des objectifs contradictoires. La transition écologique génère de plus en plus de résistances au sein des populations. En France, le mouvement des « gueux » a contribué à lancer le débat sur la suppression des zones à faibles émissions (ZFE). Les mesures de lutte contre le réchauffement climatique sont perçues comme socialement injustes et punitives. L’action des pouvoirs publics pour modifier les comportements est considérée par un nombre important de citoyens comme attentatoire aux libertés individuelles.
La taxe carbone aux frontières assimilée à des droits de douane.
Les mesures prises par les pouvoirs publics accroissent également les tensions internationales. La taxe carbone aux frontières, que l’Union européenne entend instituer, est assimilée à des droits de douane par les pays émergents et en développement. Elle est considérée par ces derniers comme une remise en cause du libre-échange. Ils estiment que les pays occidentaux, en grande partie responsables des émissions de gaz à effet de serre de ces deux cents dernières années, ne respectent pas leurs engagements de les aider à décarboner leur économie.
L’instauration d’une bourse mondiale du carbone constituerait un moyen efficace de réguler les émissions.
Le réchauffement climatique qui ne connaît pas de frontières, fragmente de plus en plus la communauté internationale. Les États-Unis se sont ainsi retirés une nouvelle fois des Accords de Paris au mois de janvier dernier, avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Seule une solution internationale permettra de limiter le réchauffement climatique. L’instauration d’une bourse mondiale du carbone, gérée par l’ONU ou l’OMC, constituerait un moyen efficace de réguler les émissions tout en intégrant une dimension de développement pour les pays les plus pauvres.
Les émissions de CO₂ devraient être taxées, tandis que leur réduction pourrait donner lieu à l’attribution de crédits carbone. Les pays émergents et en développement pourraient se voir attribuer des crédits sous condition de réaliser, eux aussi, des efforts en matière de transition écologique.
Rien ne justifie une démission mondiale sur le sujet fondamental de l’environnement
Comme lors de la crise du Covid, des programmes mondiaux de recherche devraient être engagés afin de développer des techniques de décarbonation ou de favoriser le recours à des énergies propres dans les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Les questions environnementales devraient devenir une compétence exclusive de l’Union européenne, comme le sont celles liées aux échanges commerciaux. La production et l’acheminement de l’énergie doivent être pensés à l’échelle du continent, et non État par État.
Les difficultés de la France à relancer la construction de centrales nucléaires, ou le black-out du mois de juin en Espagne, sont autant de preuves de la nécessité de renforcer la construction européenne dans ce domaine. Face à l’emballement du réchauffement climatique, la fatalité serait de l’accepter. Cette renonciation représenterait une défaite du multilatéralisme, une condamnation du progrès technique tel que nous le concevons depuis le début de la première révolution industrielle au XVIIIe siècle. Rien ne justifie une démission mondiale sur le sujet fondamental de l’environnement. La supériorité de l’être humain repose sur sa capacité à inventer, à innover pour assurer sa pérennité. Le défi environnemental est à même de prouver que cette intelligence est toujours d’actualité.
Auteur/Autrice
-
Philippe Crevel est un spécialiste des questions macroéconomiques. Fondateur de la société d’études et de stratégies économiques, Lorello Ecodata, il dirige, par ailleurs, le Cercle de l’Epargne qui est un centre d’études et d’information consacré à l’épargne et à la retraite en plus d'être notre spécialiste économie.
Voir toutes les publications














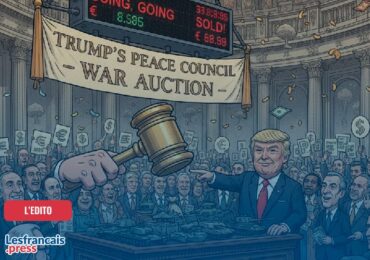









Vous qui maîtrisez les questions macroéconomiques devriez loucher du côté du grand spécialiste des cycles de tout ordre, et conseiller auprès de grandes institutions à travers le globe – Martin Armstrong. Vous vous apercevriez alors que vos prémisses sont à revoir.