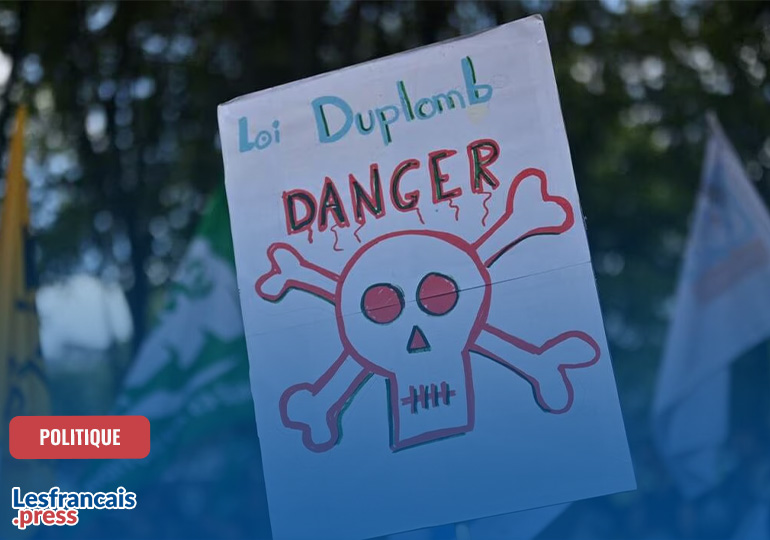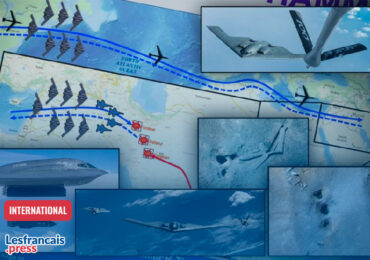C’est le succès de l’été : la pétition Duplomb. Elle a été lancée par une étudiante le 10 juillet, deux jours après l’adoption du texte du sénateur Les Républicains (LR) Laurent Duplomb, qui autorise la réintroduction sous condition d’un pesticide interdit en France mais autorisé ailleurs en Europe. Avec désormais plus d’1,5 million de signataires, elle est rapidement devenue l’initiative la plus soutenue depuis la création de cette plateforme qui permet aux citoyens d’alerter leur député sur divers sujets. Mais à quoi sert-elle ? Pouvez-vous la signer en tant que Français de l’étranger ?
Les pétitions de l’Assemblée nationale française
La plateforme des pétitions de l’Assemblée nationale permet aux citoyens d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale et de signer des pétitions déjà déposées.
Chaque pétition est attribuée à l’une des huit commissions permanentes de l’Assemblée nationale, en fonction de la thématique qu’elle aborde. Les pétitions ayant recueilli au moins 100 000 signatures sont mises en ligne sur le site de l’Assemblée nationale pour plus de visibilité.
Pour signer une pétition, il est nécessaire de s’identifier via la plateforme FranceConnect. Vous pouvez y accéder via l’identité numérique avec un passeport français et pour ceux qui disposent de la nouvelle CNIe, ils peuvent passer utiliser France identité. Cette identification a pour but de permettre l’Assemblée nationale de s’assurer que les auteurs ou les signataires de pétitions sont bien des personnes physiques majeures et que chaque pétition n’est signée qu’une seule fois par une même personne physique. Il faut savoir que les noms et prénoms des auteurs sont rendus publics sur la plateforme, tandis que les signataires demeurent anonymes (aucune donnée personnelle n’est conservée les concernant).

Après attribution de la pétition à une commission, les députés de la commission désignent un député-rapporteur qui propose ensuite soit d’examiner le texte au cours d’un débat faisant l’objet d’un rapport parlementaire, soit de classer la pétition. A partir de 500 000 signatures provenant d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, la conférence des présidents peut choisir soit d’« examiner le texte au cours d’un débat faisant l’objet d’un rapport parlementaire, soit [de] classer la pétition », détaille le site de dépôt de pétition de l’Assemblée. Autrement dit, ne rien faire du tout.
« Cela pourrait être la première fois, sous la Ve République, qu’une pétition est débattue en séance publique si la conférence des présidents de l’Assemblée nationale décide de l’inscrire à l’ordre du jour »
le service presse du Palais-Bourbon.
La loi Duplomb ?
Adoptée le 8 juillet au Parlement, la loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », dite loi Duplomb, prévoit notamment de faciliter les projets d’élevages intensifs, de « mégabassines » et la réintroduction à titre dérogatoire et sous conditions de l’acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Considéré comme un « tueur d’abeilles », ce pesticide est interdit en France depuis 2018, mais autorisé en Europe jusqu’en 2033. Il est réclamé par les producteurs de betteraves ou de noisettes, qui estiment n’avoir aucune alternative contre les ravageurs et subir une concurrence déloyale face aux agriculteurs européens.
« L’acétamipride est autorisé dans 26 pays sur 27 en Europe. Tous les scientifiques de toute l’Europe, sauf la France, ont donné leur aval pour continuer à l’utiliser jusqu’en 2033 », a de nouveau défendu le sénateur (Les Républicains) Laurent Duplomb ce dimanche à l’initiative du texte. En continuant d’interdire ce pesticide, la France « fait courir une concurrence déloyale » à ses agriculteurs. « Moins nous produirons en France, plus nous seront soumis à acheter des produits qui viennent d’ailleurs et qui ne correspondent pas du tout à nos normes », a-t-il ajouté.

Le retour des néonicotinoïdes, très toxiques pour les abeilles, est décrié par les défenseurs de la nature, les apiculteurs – qui dénoncent « un tueur d’abeilles » -, la Confédération paysanne (3e syndicat agricole). Des régies publiques de l’eau et des scientifiques ont aussi alerté sur la « persistance » de ces substances dans l’environnement et les risques pour la santé. Les effets du pesticide sur l’humain sont également source de préoccupations, même si les risques restent incertains, faute d’études d’ampleur.
La loi Duplomb vise également à faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures, dans un contexte de raréfaction de la ressource liée au dérèglement climatique. Des associations ont mis en garde contre « l’implantation de mégabassines », ces immenses réserves constituées l’hiver en puisant dans la nappe phréatique ou les cours d’eau, « qui accaparent » les ressources en eau « au profit de l’agriculture intensive ».
Présentée comme l’une des réponses à la colère des agriculteurs de l’hiver 2024, en levant les « contraintes » à l’exercice de leur métier, la loi a fait l’objet de vives critiques. Cependant, les premiers syndicats agricoles – la FNSEA, Jeunes agriculteurs et la Coordination rurale – sont d’ailleurs favorables à cette loi, notamment les producteurs de betteraves sucrières qui affirment n’avoir aucune solution pour protéger efficacement leurs cultures. Ils redoutent la concurrence d’importations de sucre produit avec des pesticides interdits en France.
L’objectif de la pétition
La pétition accuse les parlementaires de « légiférer contre l’intérêt général » et dénonce une loi « inconstitutionnelle », qui incarne, selon le texte, une « attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens ».
Car cette loi a connu un parcours expéditif au Parlement avec une motion de rejet préalable, déposée par son propre rapporteur Julien Dive (LR) pourtant favorable au texte. L’objectif étant de contourner un mur de milliers d’amendements déposés par des écologistes et des insoumis à l’Assemblée, que le rapporteur avait qualifié d’« obstruction ». Rejetée par ses propres soutiens à l’Assemblée pour s’éviter le débat sur les amendements de la gauche, la proposition de loi LR a été, de fait, renvoyée en commission mixte paritaire, où une quinzaine de sénateurs et députés, à majorité à droite, ont eu la charge de trouver un texte de compromis. Celui-ci a ensuite été adopté après un ultime vote au Sénat puis, mardi 8 juillet, par 316 voix contre 223 à l’Assemblée nationale, lors d’une dernière séance tendue. Et c’est ce parcours législatif que remet en cause la pétition.
Vers un débat parlementaire ?
En France, seule une loi peut abroger une autre loi. « Le droit de pétition, en France, ne mène pas à grand-chose », souligne Benjamin Morel, politologue, maître de conférences en droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas sur FranceInfo. Cela « met une pression politique » sur les députés. Il pourrait toutefois « donner naissance à un texte, si un groupe politique souhaite le défendre dans sa niche », a-t-il ajouté
Mais comme nous l’avons vu plus haut, à partir du seuil des 500 000 signatures, et à condition qu’elles soient issues d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, une pétition peut entraîner l’organisation d’un débat en séance publique à l’Assemblée nationale. C’est la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale (composée de la présidente de l’Assemblée et les présidents des groupes parlementaires) qui peut le décider. Et la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet (Renaissance), s’est dite, dimanche, « favorable » à l’organisation d’un débat à la rentrée parlementaire.
Un tel débat serait une première dans l’histoire de la Ve République, mais la loi ne sera pas réexaminée sur le fond et encore moins abrogée. Ce débat « ne pourra en aucun cas revenir sur la loi votée », a prévenu la présidente de l’Assemblée nationale, pour qui la loi va, selon elle, « sauver un certain nombre de nos agriculteurs ».
Auteur/Autrice
-
L'AFP est, avec l'Associated Press et Reuters, une des trois agences de presse qui se partagent un quasi-monopole de l'information dans le monde. Elles ont en commun, à la différence de son prédécesseur Havas, de ne pas avoir d'actionnaire mais un conseil d'administration composé majoritairement d'éditeurs de presse.
Voir toutes les publications