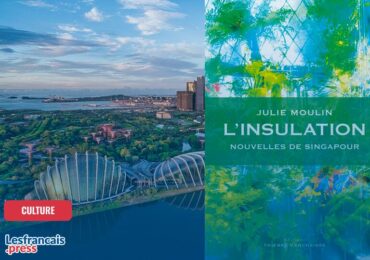En Iran, il y a les slogans politiques, les murs couverts d’inscriptions clamant la liberté et la fraternité. Il y a aussi les fils numériques poétiques ou enfiévrés d’une jeunesse qui préfère périr plutôt que de se soumettre au régime théocratique. Ces Iraniens(es) insurgés(es) forgent tous les jours un lexique de résistance. « Un orage de mots » analyse la révolution des Iraniens dans le texte. La révolution “Femme, Vie, Liberté” dite par celles et ceux qui la font et dont Chahla Chafiq donne à entendre le tumulte. Plus qu’un essai, c’est une anthologie de la révolte, une recension mémorielle, un essai documenté au service de la cause des Iraniens et Iraniennes épris de liberté.
Iran : le point de rupture (septembre 2022)
Le 16 septembre 2022 marque un point de bascule dans l’histoire contemporaine des révoltes du peuple iranien contre ses dirigeants. Mahsa (Jina) Amini, 22 ans, est arrêtée par la « police des mœurs » pour un voile considéré comme « mal porté ». Elle meurt en détention. Sa mort réveille une colère profonde et cristallise des frustrations accumulées depuis des décennies. Rapidement, le slogan « Femme, Vie, Liberté » devient le cri central du soulèvement.

Les manifestations gagnent toutes les régions d’Iran, des villes kurdes à Téhéran. La répression est brutale : tirs, arrestations, disparitions, violences sexuelles en détention. Un rapport de l’ONU (Organisation des Nations Unies) rend le régime responsable de la « violence physique » ayant causé la mort de Mahsa Amini, et dénonce des « meurtres extrajudiciaires » et une répression disproportionnée. La situation est plus que jamais clivée entre le camp de la dictature et ses affidés et celui d’un peuple en résistance dont la première arme est un courage sans borne.

Le texte de Chahla Chafiq : donner voix à la résistance
Chahla Chafiq, sociologue franco-iranienne, ne propose pas seulement un essai. Elle s’appuie sur une collecte de mots : slogans, graffitis, publications numériques, extraits de poèmes et témoignages. Dans « Un orage de mots », elle articule une « poétique de révolution » : comment le mot devient arme, comment le langage incarne la dissidence. « Avec “Femme, Vie, Liberté”, tout devient visible et audible. On voit et entend tout un peuple, femmes et hommes. »
Citations et mémoires des figures de la lutte
La chanson *Baraye* de Shervin Hajipour, composée à partir de tweets commençant par « barâye » (“pour / à cause de”), est devenue l’hymne du soulèvement. Elle évoque la pluralité des raisons de la lutte : « For dancing in the streets… for fear when kissing… », avant de conclure par « Femme, Vie, Liberté ».
Le chant *Soroode Zan*, écrit par Mona Borzouei et interprété par Mehdi Yarrahi, fut publié dix-huit jours après la mort de Mahsa Amini. Il commence par le slogan « Femme, Vie, Liberté » et a valu l’arrestation de sa parolière. C’est ce chant qui est devenu l’emblème d’une révolution portée par des jeunes femmes qui ôtent leur voile en signe de protestation, qui refusent de rentrer dans le rang, s’opposent aux mensonges du régime qui maquille la mort de nombreuses jeunes personnes en révolte en les faisant passer pour des provocateurs ou des individus fragiles au plan médical. Parmi les figures de la lutte emblématique :
Asra Panahi, 15 ans, morte à Ardabil après avoir refusé de chanter un hymne pro-régime. Aylar Haghi, étudiante en médecine, tuée à Tabriz par un tir en novembre 2022. Nika Shakarami, 16 ans, dont la mère déclara après sa mort : « Je resterai toujours dans l’agonie de ta souffrance… mais je t’aime. Quand je vois cette graine pure de ta pensée — liberté, courage et honneur — fleurir dans d’autres cœurs… je suis heureuse. »
Ce qui frappe à travers la figure de ces combattants de la liberté disparus au service de leur cause c’est leur courage physique face au danger, à la répression et les immenses ressources littéraires qu’ils mettent au service des mobilisations.

« Ce livre est une archive du présent et un manifeste pour l’avenir. »
Analyse critique et portée de l’ouvrage
« Un orage de mots » ne fait pas de la révolution un récit héroïque centré sur quelques leaders, mais un chœur polyphonique. L’ouvrage insiste sur l’épanouissement des mots face à la brutalité de la répression : slogans, chants, graffitis et tweets face aux coups, à la torture et aux mises à mort par pendaison. Les mots ne sont pas impuissants mais au contraire structurant, pour mobiliser tout un peuple, organiser des manifestants. Le soulèvement n’est pas isolé mais s’inscrit dans une longue histoire des luttes des femmes iraniennes.

Chahla Chafiq produit ainsi une archive vivante, un outil de mémoire. Son format rassemblé, ses renvois aux textes d’une jeunesse éblouissante de courage, deviennent un cri de ralliement qui dépasse les frontières de l’Iran. Avec « Un orage de mots », Chahla Chafiq offre plus qu’une analyse : elle fait entendre la polyphonie d’une révolution en train de s’écrire. Ce livre est une archive du présent et un manifeste pour l’avenir. Il rappelle que dans les ténèbres, la lumière persiste à travers les mots. « Je resterai toujours dans l’agonie de ta souffrance… mais je t’aime. Quand je vois cette graine pure de ta pensée — liberté, courage et honneur — fleurir dans d’autres cœurs… je suis heureuse. », Mère de Nika Shakarami
Echange libre avec Chahla Chafiq
Lesfrancais.press : « Vous dites que ces mots « volés à la censure » sont à la fois spontanés et enracinés dans la poésie iranienne. Pouvez-vous expliquer comment vous avez tissé ce lien entre héritage littéraire iranien et langage contemporain des révoltés ? »
Chahla Chafiq : « Les manifestants ont fait repris et réactivé des mots de poètes connus et des thèmes récurrents dans la poésie contemporaine iranienne. Le slogan « Je suis la souffrance commune, crie-moi », par exemple, est extrait d’un poème de Shamlou, célèbre poète contemporain. Les slogans qui revendiquent de reconstruire la patrie, telles que « Que cette terre devienne enfin notre patrie » reprennent également un thème récurrent de la poésie contemporaine. Citons par exemple, la grande poétesse Simin Behbahani : « Je te reconstruis, patrie ». À cela s’ajoute le rythme des slogans en farsi. Farzaneh Milani, écrivaine iranienne et professeure émérite en langues et cultures du Moyen-Orient, développe ce lien dans la préface de l’ouvrage. Je le souligne aussi tout au long du texte.
Lesfrancais.press : « Quel a été votre critère de sélection parmi les milliers de témoignages, tweets, slogans ? Comment avez-vous fait le choix de ceux qui figurent dans Un orage de mots (par exemple Artin) ? »
Chahla Chafiq : « Après avoir recueilli près de 300 pages de témoignages et de slogans avec l’aide de trois soutiens de cette révolution, Zohreh, Pasha et Reza, j’ai sélectionné prioritairement les paroles des personnes tuées par le régime pendant les manifestations.
« Quant aux chansons, j’ai choisi celles qui sont devenues des hymnes
de la révolution, comme Baraye qui a fait le tour du monde»
Chahla Chafiq, « Un orage de mots » (Ed. Rue de l’échiquier)
C’est le cas d’Artin, ce lycéen ouvrier de 15 ans, qui a écrit ces mots sur Instagram juste avant d’être tué : « Un jour tout ira bien pour nous ; je ne serai peut-être plus là, si tu l’es toi, ris pour moi du fond de ton coeur. ». Ses mots ont été repris massivement par les autres manifestants. Quant aux chansons, j’ai choisi celles qui sont devenues des hymnes de la révolution, comme Baraye qui a fait le tour du monde, dans de nombreuses langues. Pour les slogans, j’ai repris les plus récurrents. »
Lesfrancais.press : « Le mouvement « Femme, Vie, Liberté » en Iran est souvent perçu comme une rupture générationnelle. Dans votre texte, comment voyez-vous ce basculement par rapport aux générations précédentes — sur le plan politique, culturel ou poétique ? »
Chahla Chafiq : « L’idée que je développe à travers l’analyse des mots des acteurs et actrices de cette révolution, c’est qu’il s’agit d’une rupture qui s’inscrit dans une continuité. Cette nouvelle génération poursuit les revendications des nombreux mouvements sociaux précédents tout en rejetant publiquement l’islamisme (par ce terme, j’entends l’idéologisation de l’islam à des fins politiques et sociales, et non pas la religion en elle-même). Dans les luttes précédentes, le rejet de l’islamisme était présent, mais sans affirmation claire en raison de la peur de la répression. Cette fois, cette peur est dépassée et le rejet devient explicite. La jeune génération a réussi a renversé le mur de la peur sur lequel se fondait le double langage, voire la double vie des Iraniens : celle que l’on mène en privée et celle que l’on est contraint d’afficher en public. »
Lesfrancais.press : « Vous vivez en exil à Paris, et vous relisez l’Iran à distance. En quoi le regard de l’exil (et le fait d’être « hors sol iranien ») vous permet ou vous oblige à une lecture particulière des mots de la révolution ? »
Chahla Chafiq : « Vivre en exil m’a permis d’explorer, dès mon arrivée en France dans les années 80, ma relation avec l’Iran de manière sensible. Ne voulant pas m’enfermer dans la nostalgie, je me suis engagée dans l’analyse de l’arrivée des islamistes au pouvoir en Iran. J’ai ainsi développé un regard critique sur la révolution de 1979, à laquelle j’avais participé et qui avait abouti au pire des régimes – alors même que mes camarades et moi-même n’adhérions pas à cette idéologie.
« La distance de l’exil va de pair avec la liberté de dire. Je peux écrire librement, sans ressentir le poids de la censure islamiste »
Chahla Chafiq, « Un orage de mots » (Ed. Rue de l’échiquier)
À l’époque j’ai voulu comprendre ce qui avait amené à cette catastrophe et transmettre la compréhension que j’en avais. Ensuite, j’ai observé et suivi les générations suivantes, celles qui étaient dans l’action à travers leurs mouvements, leurs réflexions, leurs créations, tout en regardant le tableau social, politique et culturel dans son ensemble. Ainsi, dans mon roman Demande au miroir (2015), je mets en scène la confrontation de personnages appartenant à différentes générations, en Iran et en exil.
Dans mon essai, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir (2018), je me penche sur les blogs des jeunes Iraniens, les grands frères et grandes sœurs de la génération Femme, Vie, Liberté. La distance de l’exil va de pair avec la liberté de dire. Je peux écrire librement, sans ressentir le poids de la censure islamiste. »
Lesfrancais.press : « Si l’on pense au rôle de la répression en Iran (police, mollahs, censure), comment est-ce que les mots peuvent survivre malgré la violence ? Dans votre essai, vous évoquez la métaphore du « vent » — jusqu’où le langage est-il un acte de contamination (c’est-à-dire qu’il se propage malgré les murs) ? »
Chahla Chafiq : « Malgré sa férocité, la censure n’a jamais pu empêcher la circulation des mots. Si, avant le développement d’Internet et des réseaux sociaux, les écrits circulaient parmi la diaspora, dès les années 2000, la prolifération des blogs des jeunes a permis la création d’espaces très difficiles à contrôler grâce à Internet et à l’anonymat qu’il permet. Quand des blogs étaient fermés, d’autres s’ouvraient. Les mots s’envolaient de l’un à l’autre. Dans Femme, Vie, Liberté, la même chose se produit. Les mots des jeunes sont comme des graines emportées par le vent, elles germent et fleurissent ailleurs, même quand ce régime sanguinaire tue leur auteur.
En enregistrant ces mots et en documentant ces faits, Un orage de mots atteste la victoire des mots sur la censure. Une victoire qui tient à la lutte des femmes et des hommes qui ont la volonté d’exister malgré la répression. Une volonté universelle, tout comme l’envie de liberté.”
Auteur/Autrice
-
Boris Faure est l'ex 1er Secrétaire de la fédération des expatriés du Parti socialiste, mais c'est surtout un expert de la culture française à l'étranger. Il travaille depuis 20 ans dans le réseau des Instituts Français, et a été secrétaire général de celui de l'île Maurice, avant de travailler auprès des Instituts de Pologne et d'Ukraine. Il a été la plume d'une ministre de la Francophonie. Aujourd'hui, il collabore avec Sud Radio et Lesfrancais.press, tout en étant auteur et représentant syndical dans le réseau des Lycées français à l'étranger.
Voir toutes les publications