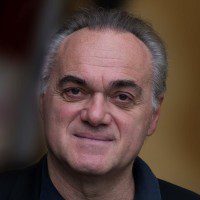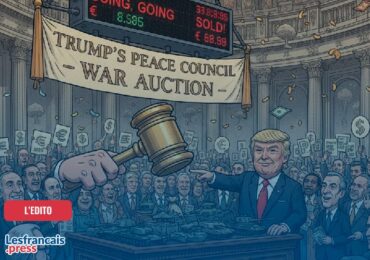On appelle économistes des professeurs qui n’ont jamais fait d’économie, comme on appelle politiste des journalistes qui n’ont jamais fait de politique. Hélas, leur influence fut et reste démoniaque : Peste soit les économistes ! À l’exception provisoire de Philippe Aghion, notre cinquième prix Nobel d’économie : Bravo, cocorico. Avec Esther Duflot et Jean Tirole, la France produit des économistes et cumule les déficits. Inconnu en France, Gerard Debreu, premier Nobel français en économie, élabora une théorie mathématique qui, selon le second prix Nobel, Maurice Allais, « n’avait aucune valeur scientifique, tant elle était totalement étrangère au monde de l’expérience. » Allais, qui se disait « socialiste concurrentiel », s’y connaissait en théorie : il avait écrit un « Traité d’économie pure » et sa fameuse « Théorie héréditaire, relativiste et logistique de la demande de monnaie et du taux d’intérêt » est sur toutes les lèvres. Allais proposa de supprimer l’impôt sur le Revenu, l’impôt sur les sociétés pour les remplacer par un impôt sur le capital de 2%. Voilà l’origine de la taxe Zucman. Ce dernier a été rabroué par le nouveau Nobel: « Tu veux faire de la France une prison fiscale ! », a lancé Aghion.
Keynes, référence du vingtième siècle, fut un des rares économistes à pratiquer l’économie : il fut un spéculateur avisé. Pour le reste, heureusement, il ne fut pas toujours suivi : haut fonctionnaire, il prônait le désarmement unilatéral de l’Empire britannique avant-guerre. Un idiot utile pour les nazis.
Plus les institutions sont « inclusives », plus le pays est prospère.
Adam Smith, lui, ne se prétendait pas économiste, mais philosophe. Titre dont s’honorait Marx. Le Nobel Paul Samuelson, dans son manuel d’Économie, prédisait la future domination économique de l’Union soviétique. Bientôt les études marxistes creuseront ce mystère : comment tant d’intelligences idolâtrèrent une pensée aussi pauvre en économie qu’en histoire. Étrange fascination dont le ressort gît peut-être dans le droit au massacre que la pensée génère. « Il n’est pas une idée née d’un esprit humain qui n’ait fait couler du sang sur la terre. », dixit Maurras, dont les siennes furent un exemple. Mieux vaut donc des économistes sans idée. Social-démocrate et spécialiste de la destruction créatrice, Philippe Aghion est aussi brillant qu’humble, ce qui est à son honneur.
Dans son cours au Collège de France, à la suite de ses amis Nobel Acemoglu, Robison et Johnson, Aghion insiste sur « le rôle des institutions dans le décollage de la croissance ». Ils tentent d’expliquer les causes de l’inégalité entre les nations.
Leur thèse : la pauvreté, comme la richesse, dépend des institutions politiques. Politique d’abord ! Plus les institutions sont « inclusives », plus le pays est prospère. Comment avoir des institutions inclusives ? Là revient l’économie : quand le pouvoir trop appauvrit, parfois le pouvoir s’appauvrit et tombe. Quand la population trop s’enrichit, le pouvoir se partage, ou tombe. Quand il tombe, que devient-il ?

Ni l’or, le pétrole, le climat, la géographie, les maladies, religions, cultures, n’expliquent richesse et pauvreté.
La décapitation de Jacques II d’Angleterre a plus favorisé la Révolution industrielle que la machine à vapeur. Déjà connue en Chine et à Byzance, elle amusait l’empereur. La France de Louis XIV dut battre en retraite face aux marchands des Pays-Bas « républicains ». Les colons américains s’émancipèrent de leurs Lords, ce que ne firent les colons hispaniques. L’Amérique latine conserva un système féodal, mélange d’esclavage, de pauvreté, et de guerre civile permanente. Le miracle grec, fut aussi un miracle économique, facilité par la diversité des cités, des échanges, des monnaies.
Ni l’or, le pétrole, le climat, la géographie, les maladies, religions, cultures, n’expliquent richesse et pauvreté. Les institutions seules, quelle que soit la latitude, forgent la matrice.
Plus les institutions sont « inclusives », font participer la population, plus le degré de liberté des acteurs est large, plus la capacité d’innovation a de chances. L’innovation est inversement proportionnelle à la part de captation des douaniers (l’État) ou des contrebandiers (pirates, oligarques, cartels légaux et illégaux).
Quels sont les pays les plus riches aujourd’hui ? Les mêmes qu’il y a cinquante ou cent cinquante ans : Europe, Amérique du Nord, Australie, Japon. Derniers venus : Corée du Sud, Taïwan et Chine.
Les pays qui osèrent la révolution industrielle, suite de la révolution des Lumières, accumulèrent plus que du capital : un capital de processus, dans la politique, l’économie, l’éducation, qui les maintient parmi les plus riches.
Plus le pouvoir est diffus, partagé, éclaté, plus l’ordre souple vit.
Aujourd’hui un autre classement se profile, celui des cent prochaines années. Cette Révolution obéit-elle aux mêmes principes ? Les gagnantes seront-elles les sociétés les plus « inclusives » ? Ou, au contraire, les moteurs de l’innovation obéiront-ils à l’émergence de nouvelles règles, de nouvelles institutions qui n’auront rien à voir avec le modèle « libéral » ?
Certains pensent seule la puissance garantit le développement. D’autres que les oligopoles, ayant le pouvoir d’informer se moquent des institutions, tout autant que les cartels se moquent des gouvernements.
Toute société nouvelle produit ses formes de pouvoir. Peut-on croire que « l’inclusivité » sera le facteur déterminant des institutions ? Le Rêve chinois prétend l’inverse.
C’est la grande bataille entre l’ordre et la liberté. Plus le pouvoir est diffus, partagé, éclaté, plus l’ordre souple vit. Sinon, l’ordre ne s’impose qu’avec le gendarme. Et il faut toujours plus de gendarmes. C’est-à-dire de corruption.
La planète devient-elle un collier de monarchies plus ou moins électives ?
La Chine arrête un chef d’entreprise par semaine, en dehors de tout cadre légal, des dirigeants disparaissent. Le Parti décide des investissements. Aux États-Unis, la capacité de l’État à favoriser arbitrairement telle ou telle entreprise ouvre la possibilité d’un régime oligarchique. « No Kings », crient les manifestants anti Trump. La planète devient-elle un collier de monarchies plus ou moins électives ?

Comment maintenir la liberté dans un monde où tout pouvoir peut tout savoir, tout manipuler ? En multipliant les contrôles du pouvoir ? Le contrôle du contrôle justifie aussi l’abus des contrôles. Multiplier les centres de pouvoir pourrait ne revenir qu’à construire des féodalités. Ce qui compte, c’est la dépendance du pouvoir au plus grand nombre. La plus grande « inclusivité » suppose la plus grande répartition du pouvoir, politique et économique.
La révolution en cours doit déboucher sur la plus grande répartition du capital possible.
Alors la révolution en cours doit déboucher sur la plus grande répartition du capital possible. L’hypercapitalisme ne suppose-t-il pas des citoyens actionnaires ? L’économiste qui expliquera comment répartir le capital -rétribution substitutive au salariat- mériterait un prix Nobel. Il obéira cette règle : avant de prendre une part de la prospérité, prendre une part du pouvoir. Il rendra alors hommage à Liu Xiao Bo, prix Nobel de la paix, mort en prison, membre du cercle de poètes « Cœurs innocents », moins innocent que les autres prix Nobel : « La fortune se nourrit de décomposition » osait-il. Destruction créatrice, dirait Aghion.
Laurent Dominati
a.Ambassadeur de France
a.Député de Paris
a.Président de la société éditrice du site Lesfrancais.press et de l’app de paiements des expatriés France Pay

Auteur/Autrice
-
Député de Paris de 1993 à 2002, Ambassadeur au Honduras de 2007 à 2010, puis au Conseil de l'Europe de 2010 à 2013, il a fondé le media lesfrancais.press dont il est le Président.
Voir toutes les publications