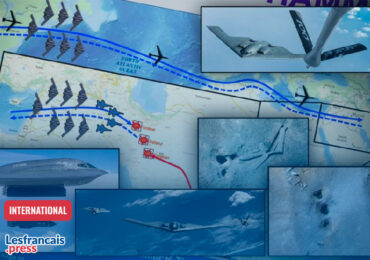Le Premier ministre, François Bayrou, l’avait martelé, chaque député aura voté en son âme et conscience, les deux textes sur la « fin de vie » en France. On fait le point pour les Français de l’étranger.
En effet en janvier 2025, le chef du gouvernement, François Bayrou, a souhaité que les sujets des soins palliatifs et de l’aide à mourir soient examinés par le Parlement dans deux textes séparés afin de donner plus de libertés quant à leur choix à chaque député. Preuve que sur les terres de la fille ainée de l’Église, pourtant laïque depuis plus d’un siècle, le suicide assisté reste un sujet tabou.
Mais finalement, en fin de journée ce mardi 27 mai, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative aux soins palliatifs et avec 305 députés qui se sont prononcés « pour », la loi créant un « droit à l’aide à mourir » est elle aussi adoptée.
Le droit à l'aide à mourir
Mais que contient la loi dédiée à l’accompagnement des malades et de la fin de vie présentée en avril 2024 par le gouvernement et qui reprend également les modifications votées par l’Assemblée nationale, avant sa dissolution en juin 2024 ?
Ainsi le droit à l’aide à mourir est institué. Il consiste à autoriser et à accompagner un malade qui l’a demandé à recourir à un produit létal. Le malade devra s’administrer lui-même le produit. Toutefois, s’il en est incapable physiquement, il pourra se le faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’auto-administration sera donc la règle et l’administration par un soignant l’exception. Une différence majeure face aux législations en Europe ou ailleurs qui légalise l’euthanasie.
Pour accéder à l’aide à mourir, le malade devra remplir cinq conditions :
- Être majeur (au moins 18 ans) ;
- Être français ou résident étranger régulier et stable en France ; Donc même en tant que non-résident, par votre citoyenneté, si nécessité, vous pourrez rentrer en France pour faire valoir ce nouveau droit.
- Être atteint d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Un amendement du gouvernement a explicité la « phase avancée » de la maladie, qui reprend la définition donnée par la Haute Autorité de santé (HAS) dans son avis du 6 mai 2025. Cette phase est « caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ». Selon l’exécutif, la prise en compte de ces repères dans la loi permettra d’éviter une application variable de l’aide à mourir, qui pourrait générer des inégalités d’accès ou exposer les médecins à des décisions isolées, sans fondement partagé ;
- Présenter une souffrance physique ou psychologique constante réfractaire aux traitements (qu’on ne peut pas soulager) ou insupportable selon lui lorsqu’il a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. Les députés ont ajouté qu' »une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir » ;
- Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Ainsi, le malade devra être capable de prendre sa décision en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix, ce qui exclut les personnes dont le discernement est gravement altéré au moment de la démarche.

Quelle procédure pour bénéficier de l'aide à mourir ?
La procédure a été précisée lors des débats qui furent vifs. Les peurs de voir les familles se débarrasser des plus fragiles ont hanté nos élus. Surtout que l’argument économique a été soulevé. En effet, les soins palliatifs sont souvent parmi les plus coûteux dans le système hospitalier. Mais comme l’a rappelé, François Bayrou, la loi n’a aucun objectif budgétaire mais se veut comme une nouvelle liberté pour tous les Français.
Les députés ont retenu le processus suivant pour déclencher le droit de choisir sa fin de vie.
Ainsi, le malade pourra déposer sa demande par écrit ou « par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ». S’il ne peut pas se déplacer, le médecin devra se rendre chez lui où dans le lieu où il est pris en charge pour recueillir sa demande. Il devra l’informer qu’il peut bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et s’assurer qu’il peut y accéder. Il devra de plus proposer de l’orienter, ainsi que ses proches, vers un psychologue ou un psychiatre.
La procédure collégiale à l’issue de laquelle le médecin prononce sa décision a été revue : elle réunira un collège pluriprofessionnel, auquel il participe et composé au moins d’un spécialiste de la pathologie et d’un soignant intervenant dans le traitement. La personne de confiance désignée par le malade pourra être associée à la procédure collégiale.
Donc finalement, on est loin des objectifs de la première mouture, puisque la décision échappe encore au malade, la décision finale appartient au corps médical tout en lui donnant la possibilité de ne pas pratiquer l’acte puisque la norme sera l’auto injection. La France n’est pas devenue la Suisse. Et en cas de refus du corps médical, c’est un long parcours judiciaire qui s’ouvrirait puisque la décision du médecin pourra être contestée devant le juge administratif par le malade uniquement (sauf cas des majeurs protégés).
En ce qui concerne l’acte en lui-même, le malade a désormais le droit de choisir la date (un minimum certains diront). Il pourra aussi décider de mourir entouré par les personnes de son choix et hors de son domicile. Mais pour éviter toute dérive, les députés ont interdit les lieux publics (voiries, places, parvis, plages, forêts, montagnes, parcs ou jardins par exemple) comme lieu possible de la mort. Une fois le produit létal administré, le texte prévoit que la présence du médecin ou de l’infirmier aux côtés du malade n’est plus obligatoire. Il devra toutefois être suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté.
Enfin, les frais exposés dans le cadre de l’aide à mourir seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie.
Auteur/Autrice
-
L'AFP est, avec l'Associated Press et Reuters, une des trois agences de presse qui se partagent un quasi-monopole de l'information dans le monde. Elles ont en commun, à la différence de son prédécesseur Havas, de ne pas avoir d'actionnaire mais un conseil d'administration composé majoritairement d'éditeurs de presse.
Voir toutes les publications