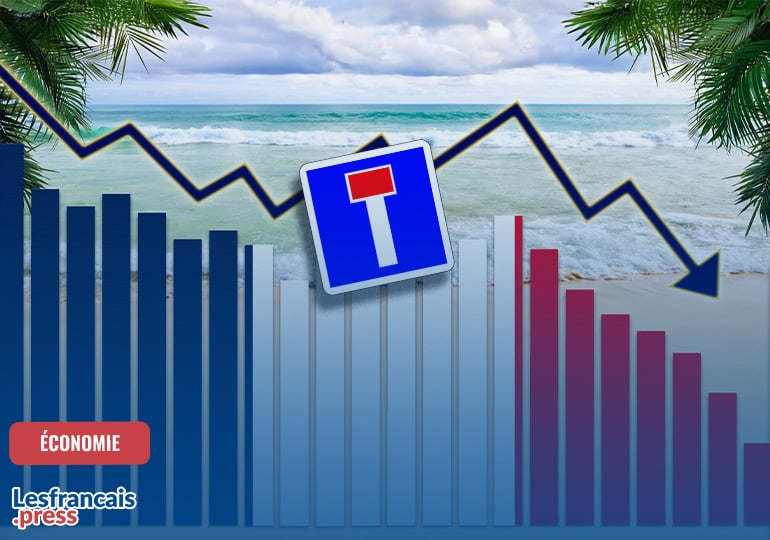La France n’est pas au bord de la banqueroute, mais elle s’enlise dans ses contradictions au point d’apparaître comme l’État malade de l’Europe. Sa croissance stagne, sa dette s’alourdit, sa productivité recule, sa dépense publique ne cesse de progresser tout comme les prélèvements obligatoires. Une langueur s’installe, sur fond de moral des consommateurs et des chefs d’entreprise miné. Un long hiver semble s’installer sur la France.
Après 0,9 % en 2024 et 1,6 % en 2023, la croissance française ne dépassera pas 0,8 % en 2025. Sur cinq ans, la moyenne annuelle est d’1 %, contre 2,3 % dans les années 1990 et 1,5 % encore dans les années 2010. Cet affaiblissement de la croissance est structurel. La productivité horaire a reculé de 1,5 % depuis 2019. La productivité par tête est inférieure de 2,2 % à son niveau d’avant-Covid.
Une sous-productivité chronique
Cette sous-productivité tient à l’insuffisance des dépenses de R&D (2,2 % du PIB contre 3,5 % aux États-Unis), au poids du secteur public dans l’emploi total (24 % contre 16 % en Allemagne) et à l’inefficacité du système éducatif : la France est se situe dans la moyenne basse du classement PISA sur le niveau des compétences des élèves. Chaque génération d’actifs entre sur le marché du travail avec un niveau de compétences stagnantes, alors que le capital technologique progresse ailleurs.
La France est confrontée à un sous-emploi chronique, en particulier chez les moins de 25 ans et chez les plus de 55 ans. Le taux d’emploi des 15-64 ans reste limité à 67 %, contre 77 % en Allemagne et 79 % aux Pays-Bas. Le taux d’activité des 55-64 ans n’est que de 56 %, contre 72 % en Allemagne. Le chômage des jeunes (15-24 ans) atteint 16 %, soit le double de la moyenne européenne.
Depuis la réforme des retraites de 2010, le taux d’emploi des seniors progresse lentement, mais reste insuffisant pour compenser la baisse du nombre de cotisants. L’inadéquation entre compétences et besoins des entreprises demeure criante : 300 000 postes dans l’industrie et la santé restent vacants.
Le taux de marge des entreprises ne représente plus que 30 % de la valeur ajoutée, contre 33 % en 2017. Cette stagnation s’explique par plusieurs causes imbriquées : vieillissement démographique, sous-investissement technologique, complexité réglementaire et baisse du temps de travail effectif. La France reste riche en capital humain, mais pauvre en efficacité productive.
La France souffre d’une hypertrophie des administrations publiques
Les dépenses publiques s’élèvent à plus de 58 % du PIB, soit le taux le plus élevé de l’OCDE. Le poids des dépenses publiques est de 50 % en Allemagne, de 47 % en Espagne, de 55 % en Italie. Il est en moyenne de 44 % au sein de l’OCDE et de 49 % dans la zone euro.
En France, cette dépense est composée aux deux tiers de dépenses sociales : retraites (15 % du PIB), santé (11 %), prestations familiales et chômage (10 %). La croissance de ces dépenses dépasse celle du PIB depuis vingt ans. Entre 2000 et 2025, le PIB en volume a augmenté de +33 %, les dépenses sociales de +54 %. Le déficit public est devenu chronique : la France cumule 50 ans de déficits successifs. À chaque crise, il s’accroît et ne revient jamais à son niveau initial. Il devrait atteindre 5,4 % du PIB en 2025.

Le déficit primaire (hors charges d’intérêts) demeure à 3,3 %, niveau qui ne permet pas de réduire le poids de la dette. Les administrations publiques devraient consentir un effort de plus de 130 milliards d’euros pour inverser la tendance. La dette atteint 115 % du PIB (environ 3 250 milliards d’euros). La charge d’intérêts dépassera 60 milliards en 2025, soit l’équivalent du budget de l’Éducation nationale ; sans inversion de tendance, elle pourrait atteindre 100 milliards d’euros d’ici 2029.
Aucun gouvernement, aucune majorité parlementaire n’ose engager une véritable réduction des dépenses publiques ni même un retour à l’équilibre, comme l’illustrent les discussions parlementaires autour des projets de loi de finances pour 2026. Les dégradations de la notation souveraine n’ont de résonance que le temps de leur annonce. Si le diagnostic est connu, aucun consensus n’existe pour changer de trajectoire.
La France souffre aussi d’un déficit commercial persistant
Depuis 2003, elle importe plus qu’elle n’exporte. En 2025, le déficit atteint 85 milliards d’euros, après le record de 160 milliards en 2022. Le solde industriel est négatif de plus de 60 milliards. Les excédents de services (tourisme, luxe, aéronautique) ne suffisent pas à compenser durablement. Le taux de couverture est tombé à 93 %, contre 105 % dans les années 1990. La part de la France dans les exportations mondiales est passée de 5,7 % en 2000 à 2,7 % en 2025.
Ce recul tient à la compétitivité-coût (salaires, énergie) et hors coût (innovation insuffisante, petite taille des entreprises, bureaucratie). La politique économique est devenue un empilement d’urgences contradictoires sans cap clair, évoluant au gré des capacités de blocage. Elle cherche tout à la fois à soutenir la consommation par la dépense publique, l’investissement par la baisse des impôts de production, et la réduction du déficit sans diminuer la dépense, en vain. Elle veut accélérer la transition énergétique sans compromettre la compétitivité.
Cette stratégie d’équilibriste a épuisé l’efficacité de l’action publique. Les multiplicateurs budgétaires s’affaiblissent. Selon l’OFCE, 1 euro de dépense publique n’ajoute plus que 0,4 euro de PIB, contre 0,8 avant 2020. La politique industrielle reste fragmentée : 25 dispositifs d’aides coexistent, rendant la stratégie de réindustrialisation illisible. 15 milliards d’euros par an de subventions, dispersées, sont octroyés sans effet mesurable sur la productivité.
La sortie de crise passe par un relèvement de la croissance potentielle. Celui-ci suppose un accroissement du volume de travail, ce qui impliquerait soit une réduction du nombre de jours de congés, soit un allongement du temps de travail. Pour l’heure, ces options sont fermement rejetées. La restauration de la compétitivité et de la productivité exige un effort d’investissement productif privé accru : il devrait passer de 11 % à 13 % du PIB d’ici 2030. La R&D, le numérique et les technologies propres doivent devenir trois priorités. Les pouvoirs publics devraient stabiliser les dépenses sociales en volume alors qu’elles ont crû de +7,6 % depuis 2019. Le gouvernement devrait viser un retour du déficit public à 2 % du PIB afin de stabiliser la dette. Un véritable programme de simplification doit être engagé : aujourd’hui, plus de 400 000 normes s’appliquent aux entreprises.
Échapper au déclin ?
Mais la France conserve des atouts : démographie moins dégradée que la moyenne de la zone euro, épargne abondante, infrastructures de qualité, secteurs dynamiques (aéronautique, défense, banques, assurances, tourisme). Mais ils ne suffisent plus à compenser ses faiblesses structurelles. Pour échapper à un déclin de plus en plus prégnant et à l’étau de la dette publique, la France doit se réconcilier avec la production et le risque.
Auteur/Autrice
-
Philippe Crevel est un spécialiste des questions macroéconomiques. Fondateur de la société d’études et de stratégies économiques, Lorello Ecodata, il dirige, par ailleurs, le Cercle de l’Epargne qui est un centre d’études et d’information consacré à l’épargne et à la retraite en plus d'être notre spécialiste économie.
Voir toutes les publications