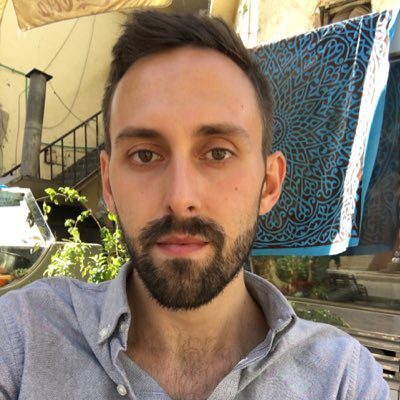En 2023, avant l’opération israélienne contre le Hamas lancée en octobre 2024 (en réponse aux attaques du 7 octobre 2023), le nombre de Français résidant dans les territoires palestiniens (Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza) était estimé entre 500 et 800 personnes. Aussi, la France abrite la plus grande diaspora palestinienne d’Europe (entre 300 000 et 500 000 personnes), principalement concentrée en Île-de-France, Lyon et Marseille. Quel est leur état d’esprit alors que la France va, désormais, reconnaitre l’État palestinien ?
Départ massif après le début des violences
200 à 300 Français ont quitté la région entre octobre 2023 et janvier 2024 par crainte des violences des colons ou de l’armée israélienne.
Pour cela, la diplomatie française a organisé une évacuation au printemps 2025. Pour être inscrit sur la liste qui permettait de passer le poste-frontière de Rafah, au sud de l’enclave, et entrer sur le territoire égyptien, le Quai d’Orsay, avec l’aide du consulat de France à Jérusalem et de l’ambassade de France au Caire, ne s’est pas limité au seul critère de la nationalité des candidats au départ.
« Compte tenu de la gravité de la crise, les critères ont été élargis par rapport à d’autres théâtres de conflit. L’effort français à cet égard est sans précédent »
Nicolas Kassianides, le consul général de France à Jérusalem au Monde le 19 avril 2024
En effet, les Palestiniens qui ont le statut de réfugiés en France pouvaient faire venir leurs familles, sous la condition d’obtenir l’accord de regroupement familial du ministère de l’intérieur. Au final, tous les Français qui ont demandé à le faire sont sortis de Gaza. Ils seraient 5 à être encore présents sur le territoire de Gaza dont Karim.
« La France nous aide avec des médicaments, mais elle ne fait rien pour arrêter les bombes. À quoi bon reconnaître la Palestine si Gaza est rayée de la carte ? »
Karim, 50 ans, médecin à Gaza (interviewé par Zoom)

Vivre le conflit depuis la France
Pour les Palestiniens réfugiés en France, l’annonce de la reconnaissance de leur État par Paris le 22 septembre 2025 suscite un mélange de fierté historique et de désillusion pragmatique.
Après des décennies de lutte pour la visibilité de leur cause, beaucoup y voient une victoire symbolique, enfin alignée sur les positions de pays comme la Suède ou l’Espagne. « C’est une étape, mais elle arrive trop tard », confie Samir, 62 ans, exilé depuis 1982, dont la famille a fui un camp de réfugiés au Liban.

Pour cette génération, marquée par les massacres de Sabra et Chatila (1982) ou les guerres de Gaza, la décision française est perçue comme un aveu tardif de leur droit à l’existence, mais aussi comme un pansement sur une jambe de bois. Les plus jeunes, nés en France et souvent confrontés au racisme ou à la méfiance institutionnelle, y voient une lueur d’espoir : « Enfin, on nous dit que notre identité n’est pas une fiction », explique Leila, 28 ans, militante à Paris, dont les grands-parents ont les clés d’une maison à Haïfa, aujourd’hui habitée par une famille israélienne. Pourtant, l’émotion est tempérée par un sentiment d’injustice persistante : comment célébrer une reconnaissance diplomatique quand, dans le même temps, Gaza est en ruines et que les colonies en Cisjordanie continuent de s’étendre ?
« Mes grands-parents ont fui Haïfa en 1948. Aujourd’hui, je manifeste pour eux… et on me traite de ‘terroriste’ sur les réseaux. »
Leila, 28 ans, étudiante à Sciences Po
Dans les quartiers populaires de Saint-Denis, Nanterre ou Marseille, où se concentrent les communautés palestiniennes, les drapeaux sont sortis, mais les discussions tournent vite à l’amertume. La mémoire des trahisons passées – comme le soutien de la France à la création d’Israël en 1948 ou son silence pendant la Nakba – pèse lourd. Certains, comme Houria Bouteldja, figure de la lutte décoloniale, dénoncent une manœuvre politique, destinée à apaiser les tensions internes sans remettre en cause les relations économiques avec Israël.
Tandis que du côté des associations (comme l’AFPS ou le CCIPPP), on salue une avancée, mais on exige des actes concrets : rupture des accords militaires, sanctions contre les colonies, ou accueil facilité pour les réfugiés de Gaza. « Cette reconnaissance, c’est bien, mais où est la pression sur Israël pour arrêter l’apartheid ? », interroge Rania, une étudiante en droit, dont la famille à Naplouse subit les violences des colons. Les réseaux sociaux bruissent de messages contrastés : des vidéos de liesse devant le consulat de Palestine à Paris côtoient des appels à la prudence. « On nous a déjà fait miroiter des espoirs en 1988, en 2012… À chaque fois, rien ne change sur le terrain », soupire Yasser, un médecin palestinien installé à Lyon, qui redoute que cette annonce ne serve qu’à redorer le blason d’Emmanuel Macron, critiqué pour sa gestion des manifestations pro-palestiniennes réprimées en 2023-2024.
Pour les réfugiés de 1948 et leurs descendants, la blessure reste ouverte
Les Palestiniens, binationaux, ou non regrettent qu’aucun droit au retour n’est évoqué dans le texte français, et la question des 6 millions de Palestiniens exilés – dont 300 000 en France – semble une nouvelle fois reléguée aux oubliettes.
« Reconnaître la Palestine, c’est bien. Mais reconnaître notre droit à rentrer chez nous, ce serait la justice »
Ahmad, 70 ans, un ancien fedayin qui a grandi dans le camp de Yarmouk, en Syrie, avant de trouver refuge en France.
Dans les cafés de Châteaudun ou de Belleville, on se demande aussi ce que cette décision changera concrètement : les checkpoints, les arrestations arbitraires et les démolitions de maisons continueront-ils demain ? La jeune génération, plus radicale, voit dans cette reconnaissance un outil de mobilisation, mais pas une fin en soi. « C’est un début, pas une victoire. La lutte continue », scande un groupe de jeunes lors d’un rassemblement place de la République, où flottent aux côtés des drapeaux palestiniens des banderoles « Libérez la Palestine, de la mer au Jourdain« .

Pour eux, la France, ancienne puissance coloniale, reste un acteur ambigu, dont le passé en Algérie et au Levant nourrit une méfiance tenace. « On ne fera pas confiance à Macron, mais on utilisera cette reconnaissance pour faire pression », assure Malik, 30 ans, membre d’un collectif BDS.
Entre espoir mesuré et colère toujours vive, les Palestiniens de France accueillent donc cette nouvelle avec lucidité : un pas en avant, mais sur un chemin encore long et semé d’embûches.
Auteur/Autrice
-
Samir Kahred a suivi ses parents dont le père était ingénieur dans une succursale du groupe Bouygues. Après une scolarité au Lycée français et des études au Caire, il devient journaliste pour des médias locaux et correspond pour lesfrancais.press
Voir toutes les publications