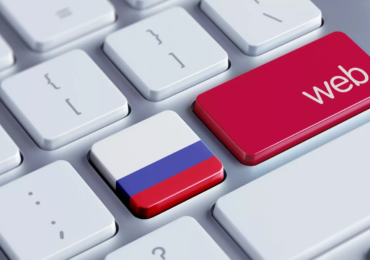Le Président de la République travaille à la réanimation du Commissariat général au Plan qui avait connu son heure de gloire après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 60. Après la défaite de 1940, les destructions liées à la guerre, la planification s’était imposée comme outil de reconstruction. L’amalgame réalisé entre le virus et la guerre aboutit donc à renouer avec cette vieille idée qui trouve ses origines dans feu l’URSS.
Au-delà de cette remise au goût du jour de la planification à la Française, l’époque est à l’interventionnisme. Les grands principes de l’économie de marché et plus globalement du libéralisme sont remis en cause au nom de la priorité affichée en faveur de l’emploi et des entreprises. Comme dans de nombreux domaines, la crise sanitaire accélère le retour du dirigisme qui était déjà bien présent depuis plusieurs années.
Cet abandon des canons du libéralisme prend plusieurs formes en concernant tout à la fois la politique monétaire, les échanges, la fixation des revenus et les finances publiques.
Une politique monétaire de moins en moins indépendante
L’indépendance des banques centrales vis-à-vis de l’exécutif s’est imposée à partir des années 70. Elle était censée protéger la monnaie des gouvernements et s’inscrivait dans le cadre des politiques de désinflation. Le principe était que les États ne pouvaient pas demander à leur banque centrale de financer les dépenses publiques à travers des mécanismes de création monétaire. Si l’indépendance formelle demeure, depuis la crise de 2008, elle est devenue une illusion. Les banques centrales sont amenées à prendre en charge une part croissante des déficits publics. Par leur politique de taux bas, elles améliorent la solvabilité des États et facilitent le financement des dépenses. Elles sont devenues des acteurs clefs de l’économie en sortant de la sphère purement monétaire. Leurs marges de manœuvre se sont réduites. En 2019, la FED a été contrainte de baisser ses taux directeurs sous pression du pouvoir politique. Par ailleurs, dans le contexte actuel, elles ne peuvent plus remonter librement leurs taux au risque de provoquer la banqueroute des États.
L’indépendance s’est transformée en dépendance. La création monétaire obéit à des considérations économiques mais aussi et surtout budgétaires. La BCE doit tenir compte de la situation des pays les plus faibles pour déterminer sa politique monétaire et non exclusivement de celle de l’ensemble de la zone euro. Si elle oubliait ce principe, les écarts de taux augmenteraient entre les États du Nord et ceux du Sud au point de provoquer un risque d’éclatement.
La crise de la Covid-19 amplifie cette tendance avec une monétisation croissante des dettes publiques. L’interventionnisme monétaire contribue à fausser la valeur de certains actifs, immobiliers ou actions. Le prix de ces actifs n’obéit plus à des considérations de rentabilité intrinsèque. Il est lié à des phénomènes de report artificiel au niveau de l’allocation des actifs. Les taux d’intérêts très bas modifient en profondeur les rapports économiques. Ils ralentissent la diffusion du progrès technique en permettant à des entreprises logiquement condamnées de se maintenir. Ils ont certainement des conséquences sur le niveau général des prix et sur les modalités de fixation des salaires.
Une socialisation croissante des revenus
La crise du covid-19 s’est traduite par une augmentation, en Europe, du chômage partiel. En France, du mois de mars au mois de juin, plus de 13 millions de salariés ont été à un moment ou un autre concernés. Ces salariés ont été payés par l’État durant leur période de chômage partiel. L’État est également venu en aide aux entrepreneurs indépendants. Cette socialisation a abouti à une augmentation des dépenses publiques qui ont ainsi dépassé 60 % du PIB. Cet accroissement est également imputable à la contraction du PIB du fait de la récession. La socialisation des revenus est un processus qui s’amplifie depuis une trentaine d’années. La création du RMI, remplacé par le RSA, l’instauration de la couverture maladie universelle, etc. sont autant de facteurs qui jouent en faveur de cette socialisation.
Des libéraux comme des socialistes poussent à créer un revenu universel pour tous. Le lien revenu, travail, couverture sociale s’estompent progressivement mais sûrement.
En France, les dépenses sociales représentent plus du tiers du PIB. Les prestations versées aux ménages constituent pour ceux qui se situent dans le premier décile (les 10 % les plus modestes) plus de 60 % de leurs revenus. Cette socialisation est également la conséquence de l’augmentation du nombre de retraités. Ces derniers qui étaient moins de 5 millions en 1981 sont aujourd’hui 16 millions en France. En 2060, ce nombre dépassera 25 millions.
Le retour de l’État
Si des années 80 aux années 2000, l’air du temps était libéral – en France, un peu moins qu’ailleurs – depuis la crise de 2008, l’interventionnisme est de retour. Les gouvernements ayant été appelés au secours après la faillite de Lehman Brothers sont de plus en plus présents sur le terrain économique. La répétition des crises, le chômage de masse, la montée des inégalités sociales et géographiques sont autant de facteurs qui incitent les dirigeants publics à intervenir de plus en plus fortement.
Avec la mondialisation, le marché est, à tort et à raison, accusé de tous les maux. « L’État nounou » est devenu un leitmotiv. Face aux États-Unis, face à la Chine, face aux multinationales de l’information et de la communication, la demande d’État protecteur augmente. La crise sanitaire avec la crainte de multiples faillites conduit à un abandon des grands principes économiques de ces dernières années. Le droit de la concurrence est mis entre parenthèse, en France comme en Europe, dans le cadre des plans de soutien sectoriel.
Le temps des oligopoles
Les États ne sont pas les seuls responsables du déclin du libéralisme. L’avènement d’oligopoles dans le secteur de l’information et de la communication symbolise la réduction de la concurrence et la création de nombreuses positions dominantes. Les GAFAM sont devenus des acteurs incontournables pour de nombreux secteurs d’activité (médias, automobile, finance, services, etc.). Du fait de leur taille, ils bénéficient d’effet de rentes qui ne sont peu ou pas redistribués, ce qui freine d’autant la croissance économique.
À la différence des années 1920 ou 1960/1970, les autorités américaines n’ont pas pu – ou n’ont pas voulu – appliquer les lois antitrust. Il en est de même en Europe. La concentration ne concerne pas que le monde du digital. Tous les grands secteurs sont concernés, l’automobile, l’aéronautique, la chimie, le médicament. Les indices qui la mesurent sont au plus haut.
Il en résulte des bénéfices accrus, symbole non pas d’une bonne santé économique mais d’un dysfonctionnement.
Pour les libéraux, le bénéfice, le profit est une récompense temporaire qui a vocation à disparaître avec l’arrivée de nouveaux concurrents. La concentration économique est également encouragée par les pouvoirs publics qui souhaitent la constitution de champions nationaux pour lutter contre des concurrents d’origine étrangère. Les plans d’aide attribués dans le cadre de la crise sanitaire accentuent cette tendance de fond.
Le retour du protectionnisme
Depuis quelques années, le libre-échange était contesté que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les manifestations contre l’accord commercial avec le Canada, la sortie des États-Unis de l’accord Pacifique, la guerre commerciale de ces derniers avec la Chine, étaient autant de signes du retour du protectionnisme. Le Brexit était également une manifestation de ce nouveau protectionnisme teinté de relents de populistes.
Le nationalisme économique semble s’imposer sur fond de pénuries de masques, de respirateurs artificiels ou de doliprane. La méfiance à l’encontre de la Chine s’est accrue avec une demande de protection des intérêts dits stratégiques. Le souhait de relocaliser certaines activités est avancé par de nombreux gouvernements. Ce processus risque de s’avérer complexe et générer des hausses de prix.
La transition énergétique en mode antilibérale
Pour certains, la transition écologique est synonyme de nécessaire décroissance ; pour d’autres, certaines activités comme l’aviation, doivent être limitées au maximum et l’économie être administrativement réorientée. Dans tous les cas, les tenants d’une transition rapide souhaitent tout à la fois un dirigisme et une remise en cause de l’initiative privée.
Pour réduire les émissions de CO2 de 50 % en 2030 par rapport au niveau de 1990 et de 100 % en 2050, ils estiment qu’un signal-prix et des mécanismes de marché ne suffiront pas. Le passage à une économie décarbonée implique des règlementations strictes (émissions de CO2 pour les véhicules, les usines, etc.) et des obligations (rénovation de l’habitat, interdiction ou limitation de circulation).
L’économie de marché est jugée incapable de réduire les émissions de CO2 en raison de sa myopie supposée même si des progrès notoires ont été réalisés ces trente dernières années. Les émissions de CO2 ont ainsi diminué de 20 % en Europe. Pour des raisons climatiques et sociales, les gouvernements interfèrent de plus en plus souvent sur les modalités de fixation des prix en particulier dans le secteur énergétique.
Plus d’État, plus de social, moins de liberté d’initiative, les fondamentaux de l’économie libérale sont mis à mal depuis de nombreuses années. Ils le sont d’autant plus qu’un processus de concentration modifie en profondeur le capitalisme. Avec la raréfaction des entreprises cotées et la diminution du nombre d’actionnaires (rachats d’actions facilités par la politique des taux bas), l’économie de marché change de visage.
Une concurrence frontale entre le modèle chinois et occidental
Entrée en concurrence frontale avec le modèle d’économie mixte et dirigiste chinois, les pays occidentaux semblent hésiter sur la voie à suivre. La compétition avec le système soviétique avait donné lieu à des inflexions de la part des pays d’économie de marché qui avaient comme en France mis en œuvre la planification. La réponse à la crainte marxiste avait été surtout donnée par le déploiement du fordisme et du keynésianisme.
Depuis une dizaine d’années, l’économie de marché est de plus en plus critiquée en son sein comme en témoigne le dernier ouvrage de l’économiste de Natixis, Patrick Artus consacrée à l’austérité salariale. La mondialisation et la digitalisation sur fond de ralentissement de l’ascension sociale mettent en tension le système capitaliste actuel. La contrainte écologique accentue cette tendance et oblige les entreprises à se réinventer tout en conservant leur rôle. L’entreprise permet là une mise en commun de moyens, travail et capital ainsi que de compétences, de savoir-faire, d’innovations, en vue de produire un bien ou un service. Elle peut prendre diverses formes, capitaliste, mutualiste, paritaire, associative, etc. Cette mise en commun s’est longtemps effectuée avec comme au théâtre une unité de temps et de lieu.
Le libéralisme avait pour vocation d’assurer une auto-régulation du système à travers le mécanisme des prix. Depuis le XXe siècle, la présence croissante de l’administration publique a fortement changé les rapports de force surtout au sein des pays européens et en premier lieu en France. Les pouvoirs publics à travers les budgets de l’État et de la Sécurité sociale influencent la conjoncture économique. Si jusque dans les années 80, le dirigisme étant direct à travers le contrôle des prix, les nationalisations, la politique du crédit, il a pris d’autres habits depuis, avec le recours croissant à la norme qu’elle soit sociale, technique, ou sanitaire. Que ce soit au niveau des télécommunications, de la finance ou de l’agriculture, le repli de l’État avait été tout relatif. Les crises en cours le remettent simplement en tête de gondole.
Laisser un commentaire