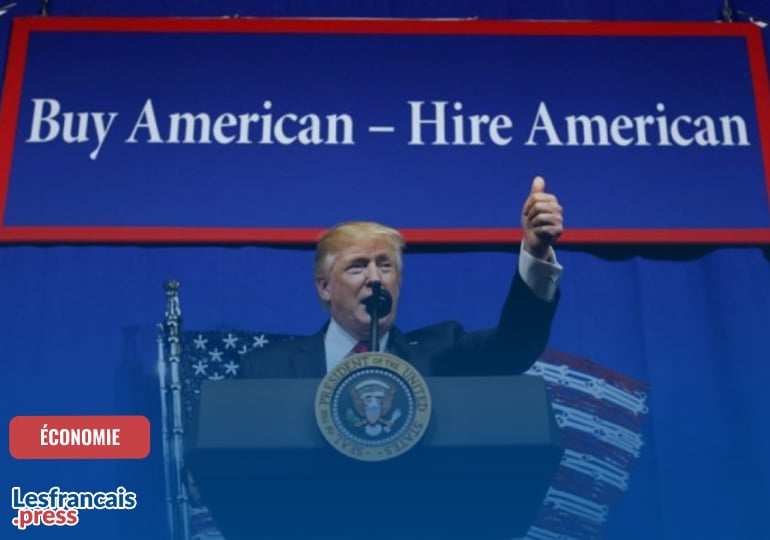Le 2 avril 2025, le « Liberation Day » selon Donald Trump, porte mal son nom. Il devrait s’appeler le jour du grand sabordage, c’est-à-dire ce jour où la première puissance économique mondiale opta pour l’isolationnisme. En décidant d’appliquer des droits de douane pouvant atteindre 70 %, le président américain tourne ainsi le dos au principe cardinal de libéralisation des échanges que les États-Unis ont imposé au reste du monde à partir de 1944, pour éviter tout retour du protectionnisme, jugé responsable de la montée aux extrêmes durant l’Entre-deux-Guerres.
Donald Trump entend appliquer des droits de douane selon une grille tarifaire contestable de manière unilatérale en dehors de tout traité international et en contradiction totale avec les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce. Les nouveaux droits américains sont décidés par décret sans être soumis au Congrès, le Président usant de ses pouvoirs en matière de sécurité nationale. Le renoncement américain est paradoxal.
L’idée que les États-Unis seraient exploités par les pays étrangers, voire humiliés, est une vue de l’esprit.
Depuis quatre-vingts ans, les États-Unis sont à l’origine d’un impérialisme indolore. Ils imposent leurs vues, l’ « American way of life », en grande partie à travers les échanges commerciaux et le dollar. Indolore, car les Américains n’ont pas eu besoin, pour imposer leurs règles, de conquérir des territoires comme l’avaient fait auparavant les Français, les Britanniques, les Portugais ou les Espagnols. Entre 1989 et 1991, ils ont gagné la lutte contre l’URSS sans mener de combats militaires, grâce avant tout à l’attraction du système dont ils sont porteurs.
L’idée que les États-Unis seraient exploités par les pays étrangers, voire humiliés, est une vue de l’esprit. Dans un système impérial, le centre bénéficie des régions périphériques. Ce fut le cas pour la Rome antique, et plus proche de nous, pour le Royaume-Uni. Le déficit commercial qui en résulte est l’expression d’une division du travail : déficit pour les États-Unis, compensé par des transferts de services et de capitaux. Les investisseurs du monde entier privilégiaient les placements américains. Ces derniers assurant un rendement élevé tout en offrant une sécurité importante, qualités caractéristiques d’un système impérial. Le cœur de ce dernier n’attirait-il pas les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs financiers du monde entier, comme autrefois le faisaient Rome ou Londres ?

Les États suzerains étaient en droit de considérer qu’ils étaient pillés de leurs talents et de leurs capitaux. Mais dans un régime de liberté de déplacement des hommes, des femmes et des capitaux, nul ne trouvait à y redire. Donald Trump pense tout autrement. Il tire un trait sur la maxime de Frédéric Bastiat « l’échange, c’est la liberté ; le protectionnisme, c’est le privilège. » en préférant le second à la première.
Les annonces de Donald Trump redonnent des cartes à la Chine, qui était à la peine.
Le Président américain estime que les suzerains ont conduit à la désindustrialisation de son pays qui n’est pas le seul en la matière. La France comme le Royaume-Uni ayant connu, depuis 1970, le même sort. Il pense que l’industrie permettra de créer des millions d’emplois quand, aujourd’hui, celle-ci prend la forme d’usines automatisées. Le retour de l’isolationnisme américain est-il un aveu de faiblesse ? Une implosion du système ? Les Américains, fatigués de plusieurs décennies d’hégémonie, souhaiteraient-ils devenir des rentiers, des prédateurs sans assumer leurs fonctions de première puissance économique ? Est-ce au contraire un sentiment d’arrogance lié à la certitude que le monde ne peut pas vivre sans eux ? Ironie de l’histoire, les annonces de Donald Trump redonnent des cartes à la Chine, qui était à la peine.
Jusqu’à maintenant, au sein de l’économie mondiale, les gentils étaient les Américains et les méchants les Chinois. Cette vision manichéenne s’est troublée en quelques semaines. Le gouvernement chinois, d’obédience communiste, devient le héraut du libre-échange. Soutenue par les BRICS, des pays émergents représentant plus de la moitié de la population mondiale et dont le PIB dépasse celui des pays du G7, la Chine a la possibilité d’instituer un système économique et financier alternatif.
Ce basculement du monde ne serait pas illogique : la première puissance commerciale tend à devenir celle qui gouverne les flux financiers. En recourant à la monnaie digitale de banque centrale sur la blockchain, les autorités chinoises pourraient lever l’obstacle idéologique et géopolitique qui, aujourd’hui, empêche le yuan de concurrencer le dollar. Depuis quelques années, elles mettent pied à pied des structures pouvant se transformer le jour venu en Fonds Monétaire International et en Banque mondiale.
L’Union européenne a également une carte à jouer.
Dans ce bouleversement mondial, l’Union européenne a également une carte à jouer. Premier marché commercial du monde avec 450 millions d’habitants, dotée d’une monnaie reconnue, gérée par une banque centrale indépendante, elle constitue une zone stable particulièrement attractive. Son goût pour les divisions, l’absence — pour le moment — d’un marché unifié des capitaux, son manque de structures budgétaires fédérales, sa faiblesse au niveau militaire constituent certes des handicaps, mais qui ne sont pas irrémédiables. L’Europe n’est jamais meilleure que quand elle est au bord du précipice. Reste à savoir si l’Europe osera jouer cette partie… ou si elle s’en tiendra au rôle de spectatrice.
Laisser un commentaire