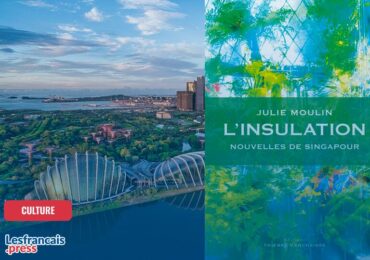En mars, Florent Coury nous avait accordé un entretien alors qu’il était en pleine formation militaire en Ukraine. Il venait de rejoindre le 1er mars ce pays comme volontaire étranger suite à l’appel du président Zelensky. Il a été le premier ou un des premiers Français à arriver sur place.
L’engagement aux côtés de la brigade géorgienne a constitué pour lui un choix patriotique et européen. Il s’est employé d’ailleurs à communiquer autour des raisons de cet engagement. Ce rôle de chargé des relations avec la presse internationale lui avait été confié par les responsables militaires, ainsi il a eu accès très largement aux médias pour évoquer l’agression russe, les défis militaires et politiques que pose cette guerre, et partager les informations sur le quotidien d’un soldat engagé et en formation.
Il a tiré de cette expérience singulière un livre, « Engagé volontaire », sorti chez Flammarion en septembre. Nous avons souhaité interroger l’écrivain autant que le patriote, et partager avec nos lecteurs le plaisir que nous avons eu à le lire. Son style enlevé, son sens du dialogue et la plongée dans le fonctionnement d’une base militaire sont totalement captivants.

L’entretien avec Florent Coury
Boris Faure : Florent, vous vous engagez en Ukraine alors que vous venez de quitter votre emploi de DRH dans un grand groupe automobile français. De cadre de haut niveau vous rentrez dans la peau d’un soldat au bas de l’échelle et ce soldat est devenu depuis un écrivain. On sent d’ailleurs entre les lignes les transformations psychologiques qui sont les vôtres, entre la quête d’un idéal européen, la volonté de se battre concrètement et les doutes face à l’incompréhension de certains de vos proches. Psychologiquement, après la phase d’exaltation et la montée d’adrénaline, le processus d’écriture, que vous avez mené à votre retour en France, vous-a-t-il apporté un apaisement durable ou n’est-il qu’une parenthèse avant une nouvelle phase d’action ?
Florent Coury : Je suis rentré fin avril, et me suis trouvé, avec l’écriture de ce livre, un prétexte pour ne pas retourner tout de suite avec mes camarades en Ukraine. Ceux-là même m’encourageaient à écrire puisque chacun doit contribuer de la manière où il est le meilleur – et il était clair que mon lieutenant avait raison me concernant lorsqu’en me faisant quitter l’unité il m’avait lâché « The pen is mightier than the sword » – (le stylo est plus puissant que l’épée). Je devais rendre ma copie en juillet à mon éditeur, pour une publication en septembre. J’avais donc planifié de pouvoir retourner en Ukraine en novembre, après la promotion du livre qui allait être un prétexte à la promotion de la cause ukrainienne. C’est durant le mois d’août qu’un ami, auquel j’avais expliqué mon projet de retour, m’a fait remarquer que certains (tels les travailleurs humanitaires) trouvent dans des formes d’action toujours plus radicales une dépendance qui leur interdit de retourner à un quotidien plus proche de celui du Français moyen. Pour la première fois – il est révélateur que la question ne se soit pas posée d’elle-même durant l’écriture, pourtant propice à l’introspection même dans le rythme très soutenu qui fut le mien – j’ai touché du doigt une potentielle contradiction entre mon engagement en Ukraine et un retour planifié à ma carrière de cadre supérieur dans le secteur privé. Je ne suis pas sûr d’avoir résolu cette contradiction, même si la réalité financière s’assurera de la résoudre pour moi tôt ou tard.
Boris Faure : Ce livre est une mise à nue sentimentale même si le récit est écrit par un esprit fort et structuré. Vous y racontez votre départ rapide et les échanges que vous avez avec votre famille une fois arrivé sur place. Vous vouliez vous expliquer auprès d’eux. Vous comprenez très vite que certains aspects de votre engagement sont incompréhensibles vus de l’hexagone et vous préférez parfois limiter les échanges WhatsApp pour éviter les malentendus. Vous êtes porté par la ferveur de vos convictions, être utile à l’Ukraine, expliquer aux compatriotes de France en quoi cette guerre met en jeu l’avenir de l’Europe, dire le conflit de l’intérieur, et vous êtes rattrapé aussi par vos sentiments de père et d’époux qui sait que le départ sera coûteux en termes personnels. Il y a notamment ces scènes poignantes où vous êtes réfugié dans un des abris anti-aériens en compagnie de familles et d’enfants ukrainiens. A ce moment là vous pensez à vos enfants restés en Belgique. Quand ils seront en âge de vous lire, comment percevront-ils votre engagement de votre point de vue ?
Florent Coury : J’ai fait face à une très forte hostilité de ma famille et de mes proches pour m’être engagé alors que j’étais père. C’est paradoxal, car d’une part, le lien qui m’unit avec mes enfants est la source de mon engagement – je considère que l’exemplarité est le seul moyen de faire vivre les idées que je cherche à leur inculquer- et d’autre part, il n’y a que pour mes enfants que mon départ ait été naturel. Tout d’abord parce qu’à leur âge, un père, ça ne craint rien. Ensuite parce que je me suis assuré de leur inculquer, dans leur éducation, les principes qui me permettront d’être compris par eux. J’avais rapidement écrit un texte dans le bus qui me conduisait de Pologne en Ukraine, lorsque j’ai réalisé que ma voix pouvait avoir un message à porter, dans lequel j’expliquais que mon fils aîné avait, le premier, mentionné son inquiétude au sujet de la guerre en me demandant si les Ukrainiens avaient des chevaliers. Ma réponse – le rassurant sur le fait que, oui, les Ukrainiens en avaient, même si certains venaient de découvrir qu’ils en étaient – venait du langage commun que j’avais créé entre eux et moi, chaque soir au fil des années, en leur racontant une histoire fantastique peuplée de peuples imaginaires et de courageux chevaliers auxquels ils s’identifiaient. C’est cette histoire fleuve, cette chronique d’une utopie où je tentais de mettre en scène le bien et le mal, le courage et la loyauté, la trahison et la douleur, qui a été la base de compréhension, en leur donnant les mots et les réflexes nécessaires. Les adultes qu’ils deviendront ne se priveront pas de me critiquer, mais j’ai envie de croire qu’il restera quelque chose de ces histoires – et bien entendu de mon livre, que j’ai aussi écrit pour eux.
Comme beaucoup d’écrivains qui ont parlé de la guerre en termes critiques, je pense ici à Céline par exemple, il y a dans ce récit l’exposé de la quotidienneté d’un soldat en formation, une chronique de l’ordinaire militaire en somme, mais aussi des moments de révolte contre l’absurdité de certaines situations : les armes manquent , vous avez seulement deux Kalachnikov pour plusieurs dizaines de volontaires, et l’organisation sur la base où tu résides est parfois déficiente. Je me permets de citer un passage du livre : « S’il s’agit d’arrêter du parachutiste ou du saboteur à coups de cure-dents géant entre les deux portes blindées je ne sais pas bien ce que je fais ici ». Comment ce récit « vérité » peut-il être perçu par les soldats qui ont partagé ton quotidien ? Faut-il tout dire des coulisses de la guerre, y compris ce qui est peu reluisant ?
J’ai écrit pour trois raisons. Pour moi-même, tout d’abord, car cela faisait des années que je souhaitais écrire sans jamais m’y mettre ; au retour d’Ukraine, je n’avais aucune excuse de ne pas le faire. Pour ma famille et mes amis, afin que ceux d’entre eux qui le souhaitent puisse savoir ce que j’avais fait (ou cherché à faire) et me comprennent mieux. Enfin, pour témoigner pour les volontaires étrangers qui partaient se battre, et qui pour la plupart sont encore là-bas à l’heure où nous parlons. Décrire le dénuement des premiers jours, les frayeurs largement dues à notre inexpérience, ou, de manière plus générale, le chaos d’une organisation multinationale qui s’ignore dans un pays qui se découvre en péril de mort est nécessaire pour recevoir la confiance du lecteur qui doit se convaincre de la sincérité du récit. Comment espérer chercher à expliquer le monde si l’on ne l’écrit pas tel qu’il est ? Présenter les volontaires sous une lumière crue, avec leurs qualités que le lecteur pourra trouver charmantes, choquantes ou risibles selon le point de vue, dire la peur panique qui me saisit pendant un exercice ou l’absurdité de ma patrouille nocturne et de l’accident qui aurait pu se produire, voilà ce que j’écris. Mon idée était donc de dire les choses comme je les ai vues, mais en gardant à l’esprit que nous participons à un affrontement armé – affrontement dans lequel j’ai résolument choisi mon camp. Je me suis donc censuré en omettant certains évènements ou sujets qui auraient pu desservir la cause que je défends, ou simplement prêter à polémiques, et cela bien au-delà du changement de noms, de chronologie ou de lieux que la sécurité imposaient, pour préserver ce que j’estimais relever d’un contexte plus apaisé et moins conflictuel. Je ne manquerai pas de revenir sur ces aspects si, comme je l’espère, j’écris un jour un livre sur l’après – l’après-guerre, l’après-combats, l’après-deuil. Je ne dis donc pas toute la vérité (et d’ailleurs qui le pourrait ?), mais je ne vois pas l’intérêt d’écrire si tout ce que je dis n’est pas la stricte vérité. Sur l’ensemble des nombreux dialogues du livre, je pense n’avoir inventé de toutes pièces que deux répliques, et seulement parce que je les souhaitais humoristiques.
Boris Faure : Très rapidement sur place vous quittez le rôle de simple soldat et vous prenez des responsabilités dans le « back office » de la guerre à savoir communiquer avec la presse mais aussi accueillir les engagés pour notamment écarter ceux qui sont là pour de mauvaises raisons. Votre formation RH et votre caractère bien trempés sont des atouts pour « lire » les motivations de ceux qui vous font face. Il y a l’exemple de ce compatriote qui visiblement appartient à l’extrême-droite et que vous allez écarter très vite à l’issue d’un entretien. Comment viviez-vous ce rôle de « garde barrière » de l’accès à la base ? Auriez-vous préféré aller en première ligne ?
Florent Coury : Le moment où l’on m’écarte de la section des volontaires appelés à se battre est un déchirement, car, aussi peu nombreuses qu’aient été ces journées où je m’imaginais partir à Kiev défendre la capitale, elles me donnaient une place claire, au sein d’un groupe de gens soudés par une cause plus grande qu’eux et par le don de soi pour la collectivité – en l’occurrence, un pays qui n’était pas le nôtre. Je n’aurais pas préféré aller me battre, et d’ailleurs dès mon tout premier texte sur les réseaux sociaux je mets noir sur blanc mon attente de me retrouver à faire la cuisine pour ceux qui savent se battre plutôt que de me battre moi-même. Mais la violence du départ, de laisser sa famille derrière soi, conduit à vouloir aller vers le choix le plus radical pour contribuer à la cause que l’on se choisit; en l’occurrence, celle de se battre. Cela a donc ouvert un moment de doute – je suis d’ailleurs sorti quelques jours d’Ukraine – sur ma contribution, avant que la raison ne prévale sur l’émotion et que j’aide d’une manière qui, à défaut d’être véritablement celle pour laquelle j’étais formée, m’a permis d’être utile.
Boris Faure : Vous souhaitiez vous engager pour les législatives de juin porté par votre idéal républicain et votre expérience européenne en Ukraine. Ce conflit vous le percevez au départ comme « une nouvelle chance pour réunir les Français autour de la république ». Une candidate d’extrême droite, pourtant pro-russe, se retrouve au deuxième tour de la présidentielle française. Et vous n’êtes pas investi comme candidat. Est-ce un échec et la traduction que la politique française doit s’ouvrir, s’européaniser, davantage intégrer une dimension internationaliste ?
Florent Coury : Je suis convaincu que la politique française s’est rabougrie, refermée sur elle-même, présentant la France comme un petit bout de planète ballotté par un monde menaçant. Le penser, c’est déjà accepter de l’être. Notre destin est de participer pleinement à la vie de notre continent et de l’humanité toute entière – parce que vouloir le contraire, c’est vivre en victimes de ce que d’autres (peuples, pays, crises) décideront pour nous, et donc un rapetissement de ce que nous sommes capables de vouloir en tant que nation, en tant que peuple. Penser la France dans le monde, s’est s’assurer de ne pas amoindrir notre souveraineté, de ne pas la réduire à une portion congrue que nous ne sommes plus capables d’expliquer à nos concitoyens, faute d’en avoir ne serait-ce que l’envie. C’est un des enjeux de la survie de nos démocraties occidentales, j’en suis certain. Et, pour le patriote que je suis, il parait évident que les périodes de notre histoire où la France s’est pensée pleinement dans le monde sont celles dont nous pouvons être le plus fiers.
Boris Faure : Je veux revenir à l’écrivain. Vous dites dans le livre que « le monde serait plus facile à vivre si les héros en chair et en os que nous croisons sur notre chemin pouvaient ressembler aux héros que nous avons lus dans les livres ». Comme Kessel ou Romain Gary, essayez-vous de devenir un de ces écrivains romanesques qui ont connu la guerre de près et se sont construits dans l’action ?
Florent Coury : Je n’essaie rien, j’admire la convergence du verbe et de l’action, et il n’y a rien que je désire autant pour moi-même. L’écriture est en soi une manière de mettre la pensée en mouvement. Je veux écrire et être pleinement dans mon temps, agir tout en cherchant à changer le monde tel qu’il est : comment ne pas m’inspirer des géants qui nous ont précédés ? Orwell et son hommage à la Catalogne pourraient être des exemples qui me sont proches.
Boris Faure : Vous êtes un homme de plume et d’action. Qu’est-ce qui attend Florent Coury dans les prochains mois ? Un retour en Ukraine ou une autre forme d’engagement pour un autre livre ?
Florent Coury : Je cherche à contribuer à la cause ukrainienne, pour le futur proche en tous les cas. L’écriture ne me quittera plus, c’est certain, y compris dans un style bien différent de mon récit ukrainien. J’ai en tête deux livres pour faire suite au premier, l’histoire dira si je les trouve dans l’action.