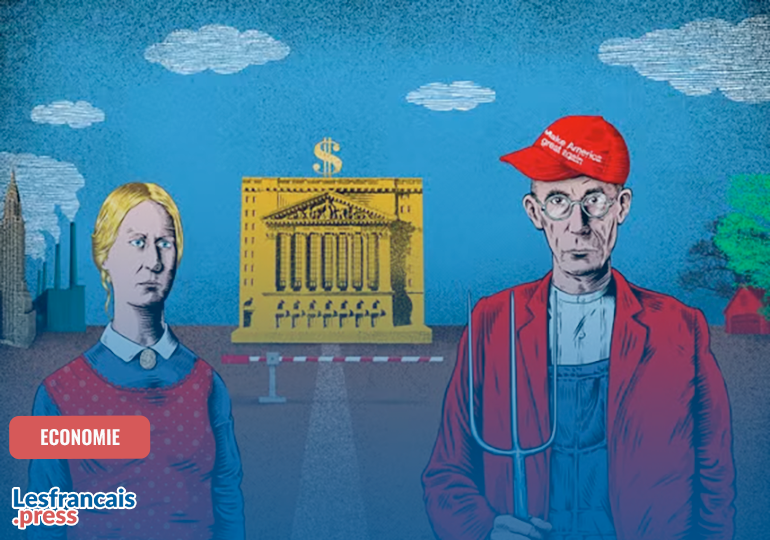En matière de protectionnisme, il n’existe jamais de bon accord. Celui scellé le dimanche 27 juillet à Turnberry (Écosse), entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Donald Trump, n’échappe pas à la règle. Il constitue sans doute le meilleur des plus mauvais compromis. Le taux de 15 % retenu pour les droits de douane représente un triplement du tarif par rapport à celui en vigueur au mois de janvier. Il reste néanmoins inférieur à celui imposé à la Chine ou à l’Inde, et équivalent à celui pratiqué avec la Corée du Sud ou le Japon. Seul le Royaume-Uni bénéficie d’un régime plus clément en raison de son absence d’excédent commercial avec les États-Unis.
15% c’est mieux que 30%
L’Europe a ainsi évité un taux de 30 % qui aurait gravement compromis les échanges transatlantiques. Les concessions exigées par Donald Trump relèvent en grande partie du trompe-l’œil. L’obligation d’acheter davantage de matériels militaires américains ne devrait guère modifier les comportements des États européens déjà largement dépendants de l’industrie de défense américaine. Quant à l’objectif d’importer pour 750 milliards de dollars de ressources énergétiques, il semble irréaliste. La complexité des marchés et les impératifs de diversification font que ces volumes ne seront, en pratique, pas intégralement destinés au continent européen.
Quel que soit son contenu, cet accord confirme une leçon ancienne de l’histoire économique : l’élévation des droits de douane va de pair avec un ralentissement de la croissance. La décision de Donald Trump de porter à plus de 15 % le taux moyen des droits de douane américains pèsera mécaniquement sur l’activité mondiale. Contrairement aux certitudes de ses partisans, une telle politique ne rééquilibrera pas la balance commerciale et ne réindustrialisera pas durablement le pays. Du XIXe au XXIe siècle, la contraction des échanges a toujours produit des effets contreproductifs.
Une solution douanière trop simpliste
La force du protectionnisme réside dans la simplicité de son raisonnement. Il flatte les peurs, désigne un responsable extérieur et permet d’éluder les responsabilités internes. Cette logique n’est pas propre aux États-Unis : elle traverse les siècles et les continents. Les producteurs étrangers sont accusés de nuire aux consommateurs — voire, parfois, de les empoisonner — ou de menacer l’emploi national. Pourtant, sauf en cas de dumping ou de pratiques anticoncurrentielles avérées, les importations ne nuisent pas à l’économie. Nul n’imagine sérieusement qu’un exportateur chercherait à porter atteinte à la santé de ses clients. Les accords commerciaux incluent, du reste, des clauses strictes en matière sanitaire.
Donald Trump, comme bien des responsables politiques, adhère à une vision erronée de l’économie nationale : il postule que la balance commerciale doit être équilibrée dans tous les secteurs. Cette approche contredit la théorie des avantages comparatifs, selon laquelle la prospérité repose sur la spécialisation dans les domaines où le pays est le moins inefficace. Chercher à tout produire soi-même est coûteux, inefficace, et conduit à un gaspillage des ressources et des compétences.
La désindustrialisation partielle des États-Unis, souvent perçue comme une faiblesse, leur a permis de se repositionner sur les technologies de l’information et de la communication, secteur dans lequel ils enregistrent des excédents significatifs. Relocaliser à tout prix la sidérurgie, l’automobile ou la chimie relève davantage du réflexe politique que d’une stratégie économique. La véritable souveraineté ne consiste pas à tout produire sur le sol national, mais à éviter la dépendance à un fournisseur unique, national ou étranger. Les monopoles, où qu’ils soient, perturbent toujours la bonne organisation des marchés.
Rapport de force
Le protectionnisme promu par Donald Trump s’inscrit dans une logique de rapport de force, voire de projection impériale avec, en toile de fond, un mercantilisme d’un autre âge. Le Président américain aime croire en la possibilité de faire financer le déficit public abyssal — à 7 % du PIB – par les importateurs tout en imposant sa vision du commerce international. Il dessert dans les faits les intérêts de son économie et de sa population.
L’accord de Turnberry illustre ainsi une tentative bancale de concilier nationalisme économique et maintien des alliances transatlantiques. Il sacrifie les principes de l’ouverture sur l’autel d’un rééquilibrage chimérique. Derrière l’apparente fermeté douanière se dissimule une profonde méconnaissance des dynamiques contemporaines du commerce mondial. Les murailles tarifaires n’empêchent pas les fissures économiques de s’élargir. Elles témoignent avant tout d’un aveu de faiblesse.
Pour l’heure, l’Europe a refusé d’entrer dans cette spirale protectionniste qui aurait pénalisé à la fois ses entreprises et ses citoyens. Ce choix est celui de la raison, mais aussi du courage politique. Il réaffirme une conviction forte : quand il est régulé et fondé sur la réciprocité, le libre-échange demeure un vecteur de prospérité partagée.
Auteur/Autrice
-
Philippe Crevel est un spécialiste des questions macroéconomiques. Fondateur de la société d’études et de stratégies économiques, Lorello Ecodata, il dirige, par ailleurs, le Cercle de l’Epargne qui est un centre d’études et d’information consacré à l’épargne et à la retraite en plus d'être notre spécialiste économie.
Voir toutes les publications