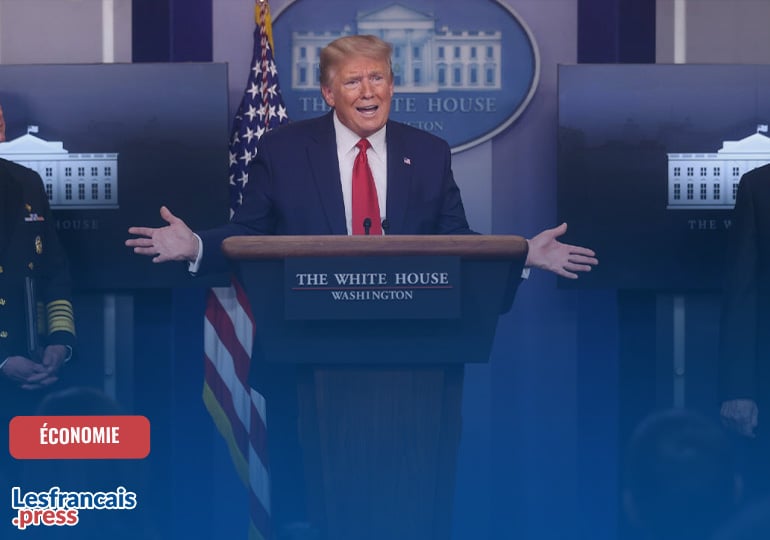Depuis la décision du 9 avril dernier de Donald Trump de suspendre durant 90 jours les majorations des droits de douane, l’économie mondiale est dans l’œil du cyclone. Tout semble calme mais la menace est tout à la fois derrière et devant. Les marchés financiers se sont assagis. Les entreprises de la haute technologie ont réussi à se faire entendre de la part de l’administration républicaine. Les alliés des États-Unis comme la Corée du Sud, le Japon voire l’Europe comptent sur les négociations pour obtenir des droits acceptables.
Même pour la Chine, tout ne semble pas irrémédiable. Le statu quo, avec un tarif de 145 % sur de nombreux produits chinois n’est « pas soutenable », a souligné le 22 avril dernier le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Donald Trump a lui-même admis que ce taux « baissera de manière substantielle ». Plusieurs produits électroniques, notamment les smartphones, ont déjà été exemptés des surtaxes. Quand Amazon a annoncé qu’elle envisageait d’afficher le coût des droits de douane à côté des prix des produits vendus, l’administration américaine a pris conscience des effets délétères de sa politique.
Un tigre de papier
L’équipe du Président américain a sous-estimé la réaction de la Chine lors de l’annonce du 2 avril dernier d’une taxe de 34 % sur les importations en provenance de ce pays. Elle a imaginé que les autorités chinoises allaient s’engager immédiatement sur la voie de la négociation. Or, les Chinois n’entendent pas céder au diktat américain et négocier en position de faiblesse. Ils considèrent que les entreprises américaines ne supporteront pas longtemps des produits chinois hors de prix.
Les Chinois ont, par ailleurs, la mémoire longue. Ils ne veulent en aucun cas revivre les humiliations du XIXe et du début du XXe siècle quand les Occidentaux ont imposé leurs règles lors des guerres de l’Opium. Les autorités chinoises n’ont de leur côté certainement pas imaginé que Washington entrerait dans une spirale de droits douaniers mortifères.
Le Président américain est aussi fier que le Président chinois. Il ne veut pas perdre la face et attend du gouvernement chinois qu’il commence par abaisser les droits de la Chine pour, le cas échéant, diminuer ceux des États-Unis.
Renouant avec de vieilles pratiques, la nouvelle vidéo du ministère des Affaires étrangères chinois présente les États-Unis comme un « tigre de papier ». Cette vidéo indique que l’obtention d’un compromis ne débouchera sur aucune clémence de la part des Américains et que « s’agenouiller ne fait qu’inviter à davantage de brutalité ». Reprenant des maximes de Mao Zedong, les grands quotidiens chinois invitent à une guerre commerciale de longue durée. Le Grand Timonier aimait ainsi à répéter que la « victoire rapide n’est bien souvent qu’une illusion »
La Chine peut-elle tenir le choc d’un quasi-embargo commercial avec les États-Unis ? Elle est confrontée à un ralentissement de sa croissance. Elle est menacée de déflation sur fond de crise immobilière. Une enquête mensuelle publiée le 30 avril sur l’industrie manufacturière montre que les commandes à l’exportation sont en chute libre. Pour tenir dans cette guerre commerciale, la Chine a besoin d’une reprise de la demande intérieure. Un plan de relance est prévu mais les consommateurs chinois restent prudents.
Perte de crédibilité américaine, gain d’influence pour Pékin.
Le bras de fer entre les deux superpuissances économiques nuit aux deux parties, les économistes évoquent un jeu à somme négative. Mais sur le plan géopolitique, il est perçu comme un jeu à somme nulle, ce qui affaiblit les États-Unis renforce la Chine.

La perte de crédibilité américaine se traduit par un gain d’influence pour Pékin à l’échelle mondiale. Les autorités chinoises défendent une ligne libre-échangiste sur fond du respect des traités internationaux. Elles veulent être le porte-parole des États pénalisés par la politique protectionniste américaine.
La Chine est incontournable.
Le ministère des Affaires étrangères chinois a ainsi appelé les autres nations à se dresser contre Washington, qui ne représente « qu’une fraction » du commerce mondial. La Chine, en revanche, est le premier partenaire commercial de plus d’une centaine de pays, et occupe une position centrale dans les chaînes d’approvisionnement asiatiques. En 2022, elle représentait plus de 19 % des importations japonaises de biens intermédiaires, plus d’un tiers de celles de la Corée du Sud, et plus de 38 % pour le Vietnam.
La Chine est incontournable. Ses partenaires asiatiques ne peuvent pas l’évincer de leurs chaînes de valeur comme le souhaiteraient les États-Unis. L’influence chinoise n’est pas sans limite, le Japon et la Corée du Sud dépendent des garanties de sécurité américaines. Les pays d’Asie du Sud-Est souhaitent rester le plus neutre possible. Contrairement à la Chine, ces pays rivalisent d’imagination pour amadouer Washington. Ils proposent d’acheter davantage d’énergie, de produits agricoles ou d’armement américains, et de lever certains obstacles commerciaux. Le Vietnam s’est engagé à lutter contre la fraude douanière, notamment le faux étiquetage de produits chinois présentés comme « fabriqués au Vietnam » pour échapper aux droits de douane.
Aider Donald Trump à redescendre de son piédestal
Ces nations, tributaires du commerce international, ne souhaitent qu’une seule chose, éviter la guerre commerciale quand la trêve de 90 jours expirera, le 9 juillet. Certaines d’entre eux espèrent même tirer avantage de la situation. La Thaïlande, par exemple, entend gagner des parts de marché aux États-Unis sur les segments de la nourriture pour animaux, du maquereau en conserve ou du calmar surgelé. De nombreux pays redoutent avant tout un effet de débordement : les produits chinois détournés du marché américain étant susceptibles d’inonder leurs marchés et fragiliser leur industrie. La vigilance est de mise.
Le président indonésien Prabowo Subianto a menacé de couler les navires transportant des textiles chinois à bas prix. En février, la Corée du Sud a imposé des droits antidumping sur certains aciers chinois. Le mois suivant, le Japon a appliqué des taxes similaires sur les électrodes en graphite importées de Chine.
L’ambition des États-Unis de marginaliser la Chine et de l’évincer des chaînes d’approvisionnement asiatiques est illusoire. Tout comme l’espoir chinois de rallier ses voisins dans un front de défi envers l’hégémonie américaine. La Chine insiste, indiquant que sa diplomatie « ne s’agenouillera pas ». Mais ses voisins, eux, font tout pour aider Donald Trump à redescendre de son piédestal.
Laisser un commentaire