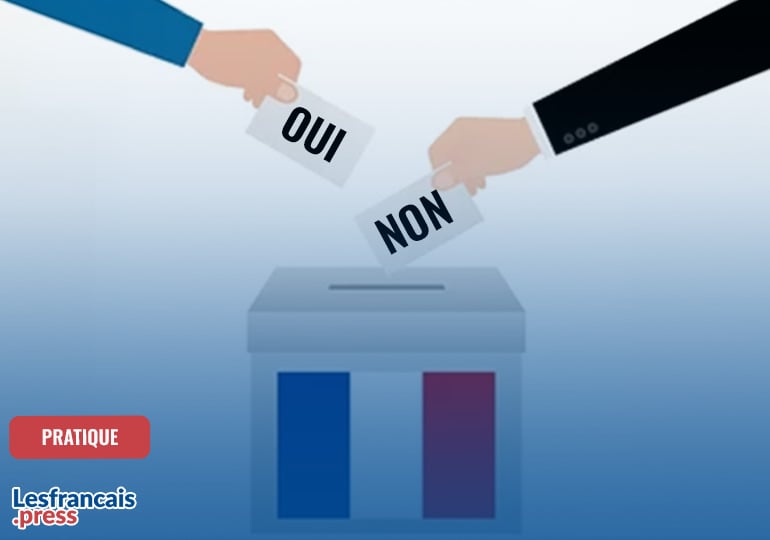Lors de sa dernière interview télévisée chez nos confrères de TF1, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de recourir à un ou plusieurs référendums. Si toutefois les sujets exacts ne sont pas encore connus, le chef de l’État a cependant laissé aucun doute sur son souhait. Oui, il posera bien prochainement une ou plusieurs questions au peuple français par voie de consultation directe. Alors autant vous proposer d’ores et déjà de faire un rappel sur ce qu’est le référendum avec ses règles, enjeux et fausses idées. Et savoir comment les Français de l’étranger pourront également s’exprimer.
Le référendum : un test de popularité pour l'exécutif ?
Cette intervention présidentielle a donc ravivé le débat sur l’usage du référendum sous la Ve République. Trop souvent conçu comme un test de popularité pour l’exécutif, il fait l’objet de malentendus réguliers, tant chez les éditorialistes que chez les responsables politiques.
« La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum »
article 3 de la Constitution
Le référendum est surtout un instrument démocratique encadré par la Constitution. Avec des modalités précises, des champs d’application limités, et des conséquences juridiques claires. Il n’est en rien un plébiscite moderne.
Référendum : Quand, comment et par qui ?
Le référendum, tel qu’il est défini dans la Constitution de 1958, se veut un moyen d’expression directe de la souveraineté nationale. Ainsi, trois articles fondamentaux structurent son usage : les articles 3, 11 et 89
- Article 3 : Cet article fondateur affirme que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Il place ainsi le référendum au cœur du pacte républicain, au même titre que le suffrage universel indirect.
- Article 11 : Le référendum dit « législatif » est une prérogative du président de la République, sur proposition du gouvernement ou conjointe des deux assemblées. Il porte sur trois domaines :
- L’organisation des pouvoirs publics ;
- Les réformes économiques, sociales ou environnementales ;
- L’autorisation de ratification d’un traité qui aurait un impact institutionnel significatif.
L’intervention du Conseil constitutionnel peut être requise pour vérifier la constitutionnalité du projet.
- Article 89 : Il s’applique aux révisions constitutionnelles. L’initiative peut émaner du président de la République, sur proposition du Premier ministre, ou des membres du Parlement. Le texte doit être adopté en termes identiques par les deux chambres. Ensuite, deux options s’offrent au chef de l’État : soumettre la révision à un référendum, ou la faire adopter par le Congrès, réuni à Versailles, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

- Référendum d’initiative partagée (RIP) : Introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, ce mécanisme associe le Parlement et les citoyens. Il doit être initié par un cinquième des parlementaires (185 sur 925) et soutenu par un dixième du corps électoral (soit environ 4,8 millions de personnes). Le Conseil constitutionnel valide la conformité de la proposition. Si les conditions sont remplies et que le Parlement ne se saisit pas du texte, le président peut convoquer les électeurs. Aucune initiative de ce type n’a abouti à ce jour.
- Référendum local (article 72-1 du Code général des collectivités territoriales) : Il permet aux collectivités territoriales d’organiser un vote sur des questions relevant de leur compétence. La participation nécessaire pour que le résultat soit décisionnel est de 50 % des inscrits. À défaut, le résultat n’est que consultatif ; ce qui en fait la seule élection française pour laquelle l’abstention et un vrai levier de pouvoir.
Les référendums de la Vème République
La Vème République a vu l’organisation de dix référendums nationaux depuis 1958.
Date | Objet du référendum | Taux de participation | Résultat |
28/09/1958 | Adoption de la Constitution de la Ve République | 84,8 % | Oui (82,6 %) |
08/01/1961 | Autodétermination de l’Algérie | 77,4 % | Oui (75 %) |
08/04/1962 | Approbation des accords d’Évian | 90,1 % | Oui (90,8 %) |
28/10/1962 | Élection du président au suffrage universel direct | 77 % | Oui (62,3 %) |
27/04/1969 | Réforme du Sénat et régionalisation | 80 % | Non (52,4 %) |
23/04/1972 | Élargissement de la CEE | 60,2 % | Oui (68,3 %) |
06/11/1988 | Accord de Matignon (Nouvelle-Calédonie) | 37,3 % | Oui (80 %) |
20/09/1992 | Traité de Maastricht | 69,7 % | Oui (51 %) |
24/09/2000 | Passage au quinquennat présidentiel | 30,2 % | Oui (73,2 %) |
29/05/2005 | Traité constitutionnel européen | 69,3 % | Non (54,7 %) |
Les taux de participation et les résultats montrent des dynamiques contrastées selon la nature des textes soumis. Il faut aussi souligner le fait que la participation n’a, dans le cadre du référendum selon l’article 11 de la Constitution, aucun impact quant à la valeur décisionnelle du résultat : les « oui » de 1988 et de 2000 ne furent pas moins décisionnels malgré une participation de moins de 40% des inscrits.
Référendum et plébiscite
La confusion entre référendum et plébiscite est ancienne. Le plébiscite, historiquement associé à Napoléon Bonaparte et à Napoléon III, est un outil de validation d’un pouvoir en place, souvent sans contre-pouvoirs.

Le référendum, tel que conçu par la Vème République, est un outil de décision sur un projet de loi ou une réforme.
Pourtant, dans la pratique, certains dirigeants ont mélangé les deux logiques. Charles de Gaulle, en 1969, considérait que le rejet de sa réforme sur le Sénat était un refus global de sa politique, et il en tira les conséquences en quittant l’Élysée. Or, rien dans la Constitution n’oblige un chef de l’État à démissionner à la suite d’un « non ». Le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence, insiste sur la nature législative du référendum : c’est le projet qui est accepté ou rejeté, non la personne qui le porte.
« Rien, dans la Constitution, n'oblige un chef de l'État à démissionner à la suite d’un non »
Rappeler cette distinction est essentiel, notamment pour les Français, qui peuvent craindre que leur vote soit détourné de son objet initial.
Le vote des Français de l'étranger lors d'un référendum
Les Français établis hors de France participent pleinement aux référendums nationaux, à condition d’être inscrits sur une liste électorale consulaire. Cette inscription, distincte de celle sur les listes électorales communales en France, est indispensable pour exercer leur droit de vote depuis l’étranger. Elle peut être effectuée en ligne, via le registre des Français établis hors de France ou directement auprès du consulat ou de l’ambassade du pays de résidence.

Une fois inscrits, les électeurs ont la possibilité de voter de deux manières. En se rendant au bureau de vote ouvert au sein de leur consulat ou ambassade, muni d’un justificatif d’identité, ou en établissant une procuration. Il est important de noter que le vote par correspondance ou par voie électronique n’est pas prévu pour les référendums. Cette participation des Français de l’étranger aux référendums nationaux permet d’exprimer un attachement aux institutions démocratiques françaises, malgré la distance géographique.
Référendum : un vote contraignant mais universel.
L’entretien télévisé du président Macron a donc replacé le référendum dans le champ du possible pour trancher certains débats de société. Si les contraintes constitutionnelles sont réelles et justifiées, elles n’interdisent pas l’usage de ce levier dans les limites prévues par la loi fondamentale.
Encore faut-il qu’il soit manié avec clarté, sur des objets précis, et non pas compris comme un exercice de légitimation de la personne du Président ou du gouvernement. Le référendum est une pierre angulaire des quelques soupçons de démocratie semi-directe voulue par la Constitution de 1958. Bien employé, il peut renforcer le lien entre gouvernants et gouvernés. Et les Français établis hors de France, citoyens à part entière, sont pleinement intégrés à cette dynamique civique nationale. L’inscription sur les listes électorales auprès du consulat est donc essentielle pour participer aux prochains référendums. Pensez-y !
Auteur/Autrice
-
Gilles Roux est un juriste, entrepreneur et auteur français qui vit dans la région de Mannheim en Allemagne depuis plus de 35 ans.
Voir toutes les publications