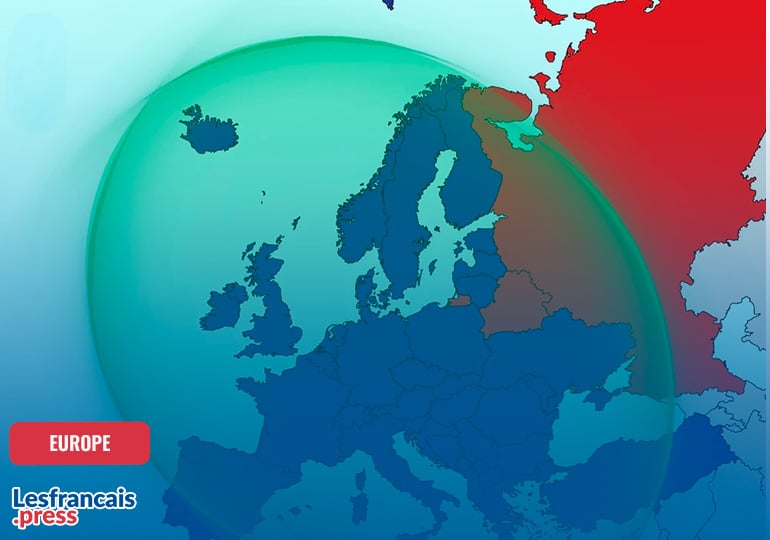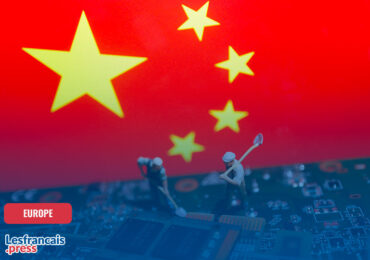Le mois de septembre a été riche en rebondissements : près de 20 drones russes ont violé l’espace aérien polonais le 9 septembre, suivis par d’autres incursions de drones non identifiés au Danemark et en Roumanie, et par des avions de combat russes en Estonie. La Pologne et l’Estonie ont tiré la sonnette d’alarme de l’OTAN en invoquant l’article 4 de l’alliance.
Alors que les dirigeants européens se réunissaient à Copenhague au début du mois d’octobre, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a souligné le besoin urgent d’un « mur de drones » européen, c’est-à-dire un réseau coordonné de radars, d’équipements de brouillage et d’intercepteurs de drones destinés à neutraliser les menaces avant qu’elles n’atteignent l’espace aérien sensible.
Le projet, rebaptisé « Initiative européenne de défense contre les drones », ne couvre pas seulement le flanc oriental de l’UE, comme prévu initialement, mais l’ensemble de l’espace aérien de l’Union.
Dans le même temps, un projet bien plus ambitieux gagne du terrain, qui pourrait intégrer le « mur de drones » dans un réseau de défense à l’échelle du continent. Le bouclier aérien européen prévoit un système de défense aérienne à plusieurs niveaux, inspiré du dôme de fer israélien, pour tout intercepter, des drones aux missiles balistiques.
Mais après des décennies de sous-investissement et de dépendance à l’égard de la protection américaine, l’Europe est confrontée à une question difficile : à quelle échéance un tel bouclier pourra-t-il devenir une réalité ? Et si les gouvernements décident d’aller de l’avant, à quoi cela ressemblerait-il en pratique ?
Le mur des drones
Les récentes incursions de drones russes, considérées comme un stratagème pour tester les défenses aériennes et la détermination politique de l’OTAN, ont mis en lumière certaines vérités gênantes.
La guerre moderne n’est plus une question de nombre, mais de précision à grande échelle. Des frappes coordonnées associant des drones bon marché à des armes haut de gamme peuvent désormais porter des coups dévastateurs aux civils et aux infrastructures critiques.
L’Ukraine en est un exemple frappant. Au cours de l’été, les attaques de drones et de missiles russes ont atteint le siège du gouvernement ukrainien et la délégation de l’Union européenne à Kiev.

L’asymétrie est brutale : la précision de masse est bon marché pour les attaquants, mais coûteuse pour les défenseurs. La réponse de l’OTAN aux récentes incursions a été efficace, mais coûteuse. L’alliance militaire a utilisé des missiles Patriot d’une valeur de 3 millions d’euros pour abattre des drones dont la fabrication ne coûte pas plus de… 20 000 euros. Un scénario qui n’est clairement pas viable à long terme.
Pour lutter contre les attaques bon marché, un système de défense aérienne à plusieurs niveaux pourrait constituer la meilleure solution. Les systèmes peu coûteux seraient d’abord déployés contre les petites menaces, les avions de chasse et les missiles haut de gamme étant réservés aux attaques plus dévastatrices, telles que les frappes balistiques et hypersoniques.
Selon cette logique, le « mur de drones » constituerait la première couche défensive du bouclier aérien élargi. Son rôle serait de détecter, de suivre et de neutraliser les drones et les munitions qui traînent. Les abattre à l’aide d’intercepteurs cinétiques et d’armes à énergie dirigée (DEW) — des lasers dont le coût n’excède pas 1 à 10 euros par tir — serait une option avantageuse par rapport au prix des Patriots.
Pour faire du « mur de drones » une réalité, certains à Bruxelles regardent vers l’Est.
« Nous avons beaucoup à apprendre de l’Ukraine, et en même temps, nous devons lui fournir une protection et un soutien financier, car en retour, elle nous aide dans la guerre des drones », a déclaré l’eurodéputée estonienne Riho Terras. « C’est un investissement dans notre propre défense. »
Le bouclier aérien européen
La mise en place d’un bouclier aérien européen ne sera ni facile ni bon marché. L’UE devra surmonter les divergences politiques, les problèmes de stockage et les coûts.
En outre, le bloc ne peut pas se contenter de reproduire le dôme de fer israélien qui protège un petit territoire avec des centres de population denses contre des menaces essentiellement à courte portée. En revanche, les populations européennes sont dispersées sur un vaste territoire et sont confrontées à l’ensemble de l’arsenal russe, des missiles Iskander à courte portée aux Avangard hypersoniques à longue portée.
Un dôme unique s’étendant sur tout le continent relève du fantasme. Le plan prévoit plutôt une mosaïque de « bulles » de défense, c’est-à-dire de multiples systèmes couvrant différents territoires, reliés entre eux pour assurer une couverture efficace de l’espace aérien de l’Europe.

La défense aérienne est une question de timing : détecter, suivre et intercepter en quelques secondes. Cela exige de la précision et une coordination transfrontalière en temps réel, les radars d’un pays transmettant des données aux lanceurs d’un autre pays.
Si des projets tels que l’initiative européenne de bouclier aérien (ESSI), menée par l’Allemagne, sont déjà en cours comme pour des achats et une maintenance conjoints, les défis ne se limitent pas au matériel. Ces systèmes doivent s’intégrer de manière transparente dans une architecture commune : la défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD) de l’OTAN.
C’est un principe familier, bien qu’inconfortable, pour les États membres. Même s’ils conservent une totale autonomie en matière de décisions d’achat, ils devront choisir des configurations qui privilégient l’interopérabilité avec les systèmes alliés. C’est là que la politique européenne prend tout son sens.
Surmonter les vulnérabilités
Selon Chris Kremidas-Courtney, chercheur au European Policy Centre, un centre de réflexion à Bruxelles, l’Europe est confrontée à un dilemme en matière d’acquisition.
La dépendance de l’Europe à l’égard des systèmes de défense étrangers, principalement américains et israéliens, est à double tranchant. Elle peut accélérer le déploiement, mais risque d’éroder l’autonomie stratégique de l’Europe. Bien qu’il existe des options locales pour la plupart des menaces, il n’y a toujours pas de véritable substitut à l’Arrow-3 d’Israël, un intercepteur hypersonique conçu pour arrêter les missiles balistiques.

Pour ajouter à ces préoccupations, l’industrie européenne de la défense reste fragmentée. « Berlin soutient IRIS-T et Patriot dans le cadre de l’initiative européenne Sky Shield, tandis que Paris et Rome défendent SAMP/T, et qu’Oslo et d’autres pays s’appuient sur NASAMS », a relevé Chris Kremidas-Courtney. En clair, chaque nation est réticente à abandonner son propre « champion », ce qui rend l’acquisition et l’intégration communes bien plus difficiles qu’elles ne devraient l’être.
Le défi n’est donc pas seulement technologique, mais aussi politique. Un système de défense multicouche crédible exige non seulement des milliards d’investissements, mais aussi un niveau de coordination que l’Europe a toujours eu du mal à atteindre. Le rêve du bouclier aérien n’est donc pas pour demain.